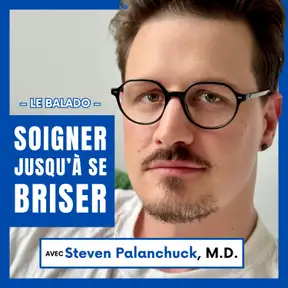Épisode 0.13 : Ce qu'on ne nous a jamais dit sur la culture toxique du soin – Emilie Banse, doctorante en psychologie
Le peu de médecins qui ont le courage sincèrement d'imposer des limites et de dire "J'ai
besoin de temps pour moi, j'ai besoin de prendre une pause, de prendre soin de moi", vont
être mal perçus.
Ils vont être perçus comme des moins bons médecins, comme des médecins plus faibles, des
médecins incompétents, comme des médecins qui n'appartiennent pas vraiment à cette
communauté prestigieuse du médecin fort.
Cette stigmatisation qui dépend directement de cette culture médicale, mais qui, est
renforcée par la réalité de l'offre des soins et par ce qui est demandé des médecins au
quotidien.
Bonjour et bienvenue à "Soigner jusqu'à se briser".
J'espère que vous allez bien.
Je m'appelle Steven Palanchuck.
Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote avant de vous présenter
mon invitée.
Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une étude qui circulait sur les réseaux
sociaux.
Le titre m'a arrêté parce que ça m'a intrigué.
Ça s'appelait "Les dimensions nocives de la culture médicale en lien avec l'épuisement
professionnel des médecins".
C'est une étude qui était ambitieuse, différente, parce que quantitative, menée en
Belgique, puis qui avait pour but d'essayer de comprendre avec des chiffres ce que
plusieurs d'entre nous avons constaté sur le terrain depuis très longtemps.
Je l'ai lue, puis ce qui m'a frappé, c'était qu'elle était en plein dans le mille.
C'était comme si cette étude-là résumait tous les témoignages recueillis jusqu'ici pour le
balado.
Donc, j'ai fait quelque chose que je fais pas très souvent en lisant des études,
c'est-à-dire que j'ai écrit à la première auteure un petit message sur LinkedIn comme une
bouteille à la mer.
Je vous la présente, elle s'appelle Emilie Banse.
Elle a 26 ans, elle est psychologue clinicienne, puis elle fait une thèse de doctorat sur
le bien-être des soignants, puis la culture médicale à l'UCLouvain, en Belgique.
Elle m'a répondu gentiment, très humainement, puis elle a accepté de venir en parler ici.
Dans cet épisode, on parle de ce que ça veut dire concrètement une culture médicale qui
use, qui isole, qui rend malade.
On parle du mythe de l'invulnérabilité, de la honte du burn-out, de la déconnexion de soi,
bref, de plein de choses dont on a parlé précédemment dans les autres épisodes du balado.
On parle aussi de comment on pourrait tranquillement commencer à changer les
Je voulais prendre un petit moment pour vous remercier, vous qui m'accompagnez dans cette
aventure de balado depuis plusieurs mois déjà.
Je dois avouer qu'en janvier, quand j'ai commencé, je ne savais pas trop dans quoi je
m'embarquais.
Je savais juste que je voulais aller à la rencontre de personnes puis essayer de décrire
la problématique de la souffrance chez les soignantes et chez les soignants du mieux que
je pouvais.
Votre réponse m'encourage à continuer.
J'ai reçu plusieurs messages de vous dernièrement, puis vraiment, ça me fait chaud au
cœur.
Je suis content de voir que le balado rejoint de plus en plus de personnes.
Ça a même été cité dernièrement dans La Presse, puis je pense que c'est grâce à vous.
Pour encourager le développement du balado, puis surtout sa découvrabilité sur les
plateformes d'écoute, je vous invite à laisser des notes
et des commentaires sur les grandes plateformes comme Apple Podcasts et Spotify.
Ça nous aide vraiment pour faire connaître les épisodes à de plus en plus de personnes,
surtout avec le contenu québécois actuellement en ligne, qui est parfois difficile à faire
connaître.
Je vous laisse avec cette discussion hyper intéressante et sur ce, je vous souhaite
une bonne écoute.
Première question pour vous, pourquoi avoir accepté de témoigner à ce balado?
J'ai accepté de témoigner parce que je suis convaincue qu'en tant que chercheuse et
chercheur, quand on mène des recherches appliquées comme c'est le cas dans ma thèse de
doctorat, c'est important de pouvoir faire un retour aux premiers concernés par les
recherches qu'on mène et donc d'aller au-delà uniquement de la publication scientifique.
Voilà, on sait que nos articles vont toucher la communauté scientifique, mais pour moi
c'est important d'aller au-delà de ça et de faire un retour finalement aux premiers
concernés, c'est-à-dire les médecins dans mon cas et je trouve que
les opportunités de vulgarisation telles que celles-ci à travers des podcasts notamment
sont des manières finalement de faire ce retour au terrain et on espère aussi du coup de
peut-être amener à la sensibilisation plus directe sur le terrain.
Et puis pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet particulièrement?
Alors, pour la petite histoire, quand j'ai décidé de me lancer dans une thèse de doctorat
en psychologie après mes études, je me rappelle avoir fait une note avec une liste de pour
et de contre à la thèse de doctorat.
Et je me rappelle très bien que dans les pour, dans les conditions que j'y mettais,
j'avais envie, si je faisais ça, si je me lançais dans une thèse de doctorat, parce qu'on
sait que c'est un parcours quand même long et parfois solitaire et assez exigeant,
de mener des recherches qui faisaient du sens pour moi et donc de mener des recherches pas
trop théoriques, mais surtout appliquées avec lesquelles on peut avoir une interaction
avec le terrain et avec lesquelles justement on peut potentiellement faire bouger des
choses si pas à court terme en tout cas à moyen terme.
Je savais en fait, j'avais l'intuition dès le départ que c'était important pour moi en
termes de sens d'avoir ces conditions-là.
Donc il y avait ce versant-là et puis en termes de thématiques,
le monde médical, c'est un monde qui m'a toujours passionné.
J'ai des proches qui sont médecins, j'ai des proches qui étudient la médecine.
J'ai moi-même considéré les études de médecine avant de m'orienter vers la psychologie.
Et donc, c'est un monde qui me passionne beaucoup, mais c'est vrai qu'autour de moi, je
vois beaucoup de médecins, dont mes proches, qui sont parfois mis en difficulté.
Je vois un système qui pèse énormément sur le dos des médecins et qui ne les aide pas à
garder
le sens du métier et qui les amène souvent à perdre des motivations pour lesquelles ils
faisaient la profession à la base.
Et donc, je me suis posé beaucoup de questions progressivement.
Donc ça, plus finalement l'opportunité de travailler en l'occurrence avec mes promoteurs
de thèse qui avaient un intérêt pour ces thématiques-là, et tous ces éléments ensemble ont
fait que les choses se sont bien mises et que j'ai décidé de m'intéresser à la base à la
question de l'épuisement professionnel chez les médecins.
Je trouve que la pandémie a vraiment remis de l'avant de notre côté, en fait, a mis en
lumière des problématiques qui étaient très profondes, enracinées depuis longtemps.
On a souvent cru que l'épuisement professionnel était une affaire d'individus.
Mais là, je constate par votre recherche que c'est probablement beaucoup plus compliqué
que ça.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
En fait, encore une fois, dans les premiers mois de ma thèse de doctorat, souvent ce qu'on
fait, c'est qu'on se plonge dans la littérature scientifique sur les thématiques qui sont
les nôtres.
Et donc moi, dans mon cas, j'ai vraiment lu énormément d'articles sur la question de
l'épuisement professionnel chez les médecins.
Et en fait, la littérature scientifique, est déjà hyper abondante sur cette question-là.
Et en lisant progressivement, en fait, pour moi, les tendances étaient très claires dans
ce que je lisais, à savoir
qu'on a tendance à penser que des solutions qui touchent le médecin individuel,
c'est-à-dire par exemple des stratégies qui vont venir augmenter la résilience du médecin,
comme par exemple l'éducation à la pleine conscience, c'est un exemple typique, sont des
stratégies qui vont aider, mais elles ne suffisent pas finalement à pallier le problème.
Et statistiquement, on voit très clairement que les interventions qui visent le burn-out
chez les médecins,
mais qui vont se situer au niveau des organisations plutôt qu'au niveau de l'individu,
vont être beaucoup plus efficaces d'un point de vue purement statistique où on voit
vraiment des différences importantes.
Et on sait que ce sont les stratégies d'intervention qui combinent les deux, c'est-à-dire
à la fois qui viennent soutenir le médecin, mais qui viennent aussi implémenter des
changements au niveau organisationnel qui vont mieux fonctionner.
Mais c'est vrai qu'en lisant progressivement et surtout en lisant la littérature
qualitative, c'est-à-dire des témoignages de médecins,
des livres rédigés par des médecins et de plus en plus les revues médicales aujourd'hui
publient des récits de médecins qui ont été à un moment donné en détresse dans la
profession et qui osent partager avec beaucoup de vulnérabilité leur vécu...
Cette littérature-là, elle m'a amené à voir à quel point – en tout cas à développer cette
intuition – que le problème n'était pas uniquement d'une part d'ordre individuel ou
d'ordre
structurel ou organisationnel, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus latent,
beaucoup plus pesant, mais sur lequel on mettait beaucoup moins de mots, qui venait aussi
jouer.
À savoir, toute une série d'attentes implicites de croyances, d'attitudes envers la
gestion de sa propre santé en tant que médecin qui sont inculquées progressivement et de
manière super implicite finalement dès les études de médecine et qui vont faire que les
médecins s'épuisent littéralement.
C'est ce qu'on appelle le curriculum caché.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment un concept très important qui a été développé en éducation médicale et qui
en fait nous dit que quand on apprend la médecine aux étudiants en médecine, on apprend
bien plus qu'uniquement ce qui est dit formellement.
Et ça, c'est le cas pour n'importe quelle formation.
Il y a vraiment une différence entre ce qui va être transmis formellement typiquement, ce
qu'on va voir comme étant décrit comme les objectifs d'apprentissage sur les sites des
facultés de médecine, par exemple.
Ça, c'est ce qui est formellement transmis.
Mais c'est rarement ça, uniquement, que les étudiants vont retenir derrière ce curriculum
formel, il y a toute cette couche informelle, cachée, beaucoup plus latente et tacite, où
on parle vraiment finalement de toutes les attitudes, les normes, les croyances qui vont
être transmises progressivement aux étudiants par des discours cachés et par la manière
dont la formation médicale est organisée.
J'ai interviewé plusieurs soignantes et soignants dans le cadre de ce balado, puis
unanimement, les gens souvent blâmaient le système.
Ça m'a fait constater en fait qu'on oublie souvent de considérer que nous sommes ce
système.
Puis je pense que quand on parle de culture, c'est un peu prendre conscience de ça aussi.
Oui, tout à fait.
Et c'est un exercice super compliqué parce que ce qui fait qu'on fait partie d'une
culture, justement, c'est que cette culture, elle devient progressivement implicite pour
nous.
Je donne souvent l'exemple quand je présente mes thématiques de recherche, par exemple, à
des maîtres de stages, donc à des superviseurs en médecine ici en Belgique.
Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller voyager dans des pays orientaux, par exemple.
C'est quand ils sont confrontés à d'autres cultures, d'autres manières de faire, qu'ils
prennent conscience de leurs propres habitudes, qui sont vraiment souvent différentes.
Pour les cultures professionnelles, c'est vraiment la même chose.
Un médecin qui est dans la profession depuis des décennies, il n'a même plus conscience
des codes qui régissent sa profession parce que ces codes sont là justement pour l'aider à
s'adapter, à fonctionner mieux dans son environnement et donc ça devient hyper implicite
et donc parfois, il y a vraiment une divergence entre la perception
de personnes extérieures à la profession et les membres qui font partie de cette culture
depuis des décennies et qui n'ont même plus conscience de ces modes de fonctionnement.
Ce qui, du coup, comme vous dites, est assez délicat, c'est que cette culture, elle est
transmise par les membres qui la constituent et donc elle est rarement remise en question
et elle va être transmise de génération en génération avec, on a l'impression en tout cas,
une culture professionnelle qui est en médecine
assez rigide, assez résistante aux changements, qui est historiquement très forte, et donc
qui va parfois venir entrer en contradiction aussi avec les attitudes, par exemple que les
nouvelles générations souhaitent adopter vis-à-vis du monde du travail.
Et ça, ça crée énormément de tensions, je pense, chez les médecins, où cette question de
tension entre les jeunes et les moins jeunes générations de médecins est énormément
évoquée comme source de souffrance des deux côtés.
C'est souvent comparé à un trauma intergénérationnel qu'on se transmet entre nous depuis
très longtemps.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions, parce que je me suis posé la
question, finalement, est-ce que les médecins qui aujourd'hui disent ne pas souffrir de
cette culture, typiquement, on pourrait dire, c'est pour stéréotyper des médecins plus
âgés qui sont en fin de carrière et qui continuent à transmettre les modes de faire aux
futures générations, mais de se demander, est-ce qu'eux ont souffert finalement de tous
ces fameux rituels de passage, on pourrait presque dire.
Et cette manière très forte de transmettre une culture rigide, est-ce qu'eux ont souffert
quand ils étaient jeunes ?
En fait, d'un point de vue de recherche, c'est très compliqué de mettre ça en évidence
parce qu'il y a tous des biais finalement de mémoire etc.
qui entrent en compte, mais de se poser la question qu'est-ce qui fait qu'un médecin
superviseur par exemple serait capable de prendre la distance avec la manière dont lui a
été formé à sa culture spécifique par rapport à ce que lui va transmettre aux nouvelles
générations de médecins.
Et ça c'est une question très compliquée et comme vous dites il y a un peu cette histoire
de "Je suis passé par là, ça m'a rendu plus fort et donc je vais aussi apprendre ceci
parce que je suis persuadé que c'est la seule manière de faire" et c'est très compliqué de
prendre la distance par rapport à ça.
Puis les conséquences, moi je les ai ressenties au quotidien, c'est-à-dire la fatigue de
compassion, le trauma vicariant, de vouloir un peu, au lieu de dire qu'on va changer un
système dysfonctionnel, bien on va demander aux individus de s'adapter parce que c'est
nous problème.
Exactement et c'est ça qui est énormément compliqué dans ce domaine de recherche, c'est
que parler de culture, c'est venir parler d'un niveau systémique d'influence et donc
parfois je me dis mais mince j'aurais jamais dû me lancer dans ce sujet de recherche parce
que les perspectives en termes de changements sont des perspectives qui vont se faire sur
le long terme.
On parle vraiment de problématiques systémiques qui doivent évoluer et c'est un changement
qui va se faire, mais qui va se faire sur du long terme et qui va prendre du temps.
Et comme vous dites, en attendant, on a plus tendance à demander aux individus de
s'adapter à ce système dysfonctionnel que de faire évoluer ce système-là justement parce
que c'est plus simple en fait d'attendre à l'individu qu'il s'adapte plutôt que de venir
remettre en question toute une organisation qui est là depuis des années et qui est rigide
en fait.
On pourrait même considérer cette culture-là d'un point de vue évolutif parce qu'il y a eu
un avantage évolutif d'exiger ça de la communauté médicale parce que c'étaient des
réflexes de survie qui ont permis de performer.
Ça sert le système, ça sert les patients qu'on demande toujours plus aux médecins.
Exactement, c'est un très bon point.
En fait, quand on s'intéresse aux définitions des cultures, elles ont ce côté adaptatif
justement, une culture professionnelle, elle existe pour une raison, parce qu'elle permet
finalement de transmettre ses codes, ses manières de faire, de se comporter, pour être
adaptée à la profession, aux exigences de la profession.
Le problème, c'est que la médecine d'aujourd'hui n'est plus du tout confrontée aux mêmes
défis que la médecine d'il y a 50, 100 ans, même plus, et donc en fait,
étant donné qu'elle a du mal à évoluer pour toute une série de raisons parce qu'elle est
très très forte et transmise de manière historique, aujourd'hui beaucoup d'auteurs notent,
beaucoup de médecins notent qu'elle n'est plus en phase avec les évolutions sociétales et
avec les nouveaux challenges que les médecins rencontrent aujourd'hui.
Ce que j'ai parfois pu lire c'est qu'on a parfois ce cliché du médecin de campagne, le
médecin de famille dont la femme était sa secrétaire qui
qui devait s'occuper de toute une série de patients dans son petit village, etc.
et qui rentrait le soir et le repas était prêt et sa femme s'occupait de tout.
Aujourd'hui, on n'est plus du tout face à ces mêmes défis.
On est dans un monde où il y a un équilibre beaucoup plus important dans la répartition
des charges en fonction du genre, par exemple, dans laquelle on attend aussi plus
d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Et puis ne parlons pas de toutes les évolutions technologiques, administratives auxquelles
les médecins sont confrontés.
Tout ça, ce sont des nouveaux défis
qui font nécessairement que la profession évolue et que la culture devrait aussi évoluer
avec.
Or effectivement, on voit que cette culture évolue beaucoup moins rapidement, en tout cas
dans la profession médicale, comparée à d'autres professions.
Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez interpellant, étant donné les enjeux en
termes de détresse psychologique qu'on observe dans la profession.
Puis on les observait surtout de manière qualitative auparavant, c'est un peu la première
fois, en tout cas pour ma part, que je vois les choses documentées de manière
quantitative, de manière aussi rigoureuse.
Oui, c'est vraiment la position qu'on a voulu prendre dès le début de ma thèse de
doctorat, c'était d'essayer d'objectiver ou en tout cas d'approcher au mieux de manière
quantitative certains aspects de cette culture médicale très forte.
Donc, en fait, il existait déjà de la littérature sur la question.
Comme je l'ai dit, beaucoup de témoignages de médecins qui partagent leur expérience de
détresse mentionnent cette question de la culture, mais ils la mentionnent dans leurs
réponses, mais n'a jamais été questionnée de manière directe.
À l'inverse, il y a groupes de recherche, je pense particulièrement au groupe de la Mayo
Clinic, qui dépend de l'Université de Stanford notamment, qui a investigué de manière
extrêmement rigoureuse dans des gros échantillons de médecins et de manière empirique
quantitative certains aspects de cette culture médicale.
Par exemple, ils ont étudié le syndrome d'imposteur en médecine qu'on décrit comme faisant
partie de cette culture médicale
de manière très rigoureuse, mais je trouvais que même si ces études sont super
intéressantes, et je me suis vraiment basée là-dessus pour créer les miennes, qu'elles
présentaient certaines limites, notamment qu'elles investiguent à chaque fois un seul de
ces éléments de manière isolée en lien à l'épuisement.
Or moi j'ai eu vraiment cette intuition rapidement qu'il fallait étudier plusieurs aspects
de manière interdépendante, interconnectée, et qui font partie de ce tissu culturel plus
large qui vient vraiment
peser sur le dos des médecins.
Elles étaient toutes réalisées dans un contexte américain.
On sait que les systèmes de soins de santé, par exemple, entre les États-Unis et chez
nous, en Belgique ou en France, ne sont pas vraiment comparables.
Et puis, le troisième point, pour moi, était une limite de ces études, c'est qu'elles
avaient investigué certains aspects, par exemple, à côté du syndrome de l'imposteur.
Ces études ont, par exemple, étudié de manière quantitative, très solidement, la
difficulté du médecin à demander de l'aide ou
à obtenir un soutien auprès d'un médecin généraliste, un médecin spécialiste et tout le
stigma qui entoure aussi la recherche d'aide qui fait partie aussi de cette culture
médicale.
Pour moi, ces études passaient à côté de beaucoup d'autres éléments que je n'arrêtais pas
de rencontrer dans la littérature et dans les témoignages que j'ai pu obtenir et de très
jeunes médecins, aussi d'étudiants en médecine, mais aussi de médecins beaucoup plus âgés
qui avaient vécu un épuisement professionnel.
Et donc,
progressivement, j'ai noté tous ces éléments qui me posaient question en tant que membre
extérieure à la profession et sur base de ça, on a voulu développer effectivement une
recherche empirique pour essayer d'approcher ces thématiques.
Après on sait que mener une étude empirique sur cette question de la culture ça peut
présenter toute une série de biais, on n'est jamais vraiment sûrs en psychologie qu'on
mesure ce qu'on veut vraiment mesurer, on essaye de prendre toute une série de
guidelines méthodologiques pour bien faire les choses, mais on sait, on peut même se poser
la question, est-ce qu'on étudie vraiment la culture ou est-ce qu'on étudie une perception
personnelle de certains aspects de cette culture ?
Il y a toute une série de questions que ça pose et donc on a conscience de toutes ces
limites, mais au-delà de ça, on voit quand même qu'il y a des choses très interpellantes
qui ressortent de ces études en termes de tendance et surtout qui parlent aux médecins,
qui viennent vraiment
mettre en lumière des espèces d'attentes tacites, un espèce de sentiment que beaucoup de
médecins partagent, mais qui est un peu impalpable et sur lequel beaucoup de médecins
n'arrivent pas à mettre des mots.
Donc je pense que la pertinence en ce sens-là de cette étude, c'est qu'elle vient essayer
de mettre des mots sur ce ressenti que beaucoup de médecins ont, mais comme vous le disiez
plus tôt, est souvent vécu de manière très isolée et qui est hyper culpabilisant, parce
que les médecins que j'ai rencontrés,
et qui sont revenus vers moi après la publication de l'étude ou après le partage des
résultats, me disent mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça soulage de se
rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce vécu et qu'en fait c'est pas forcément nous le
problème, mais qu'il a vraiment quelque chose de plus large qui est partagé en fait par
énormément de médecins, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes et de
différentes spécialisations.
Puis, ça démontre un peu le caractère systémique puis les interactions entre tous ces
facteurs-là qui, à un moment donné, vont être interreliés, puis entrent en synergie, puis
vont s'augmenter l'un et l'autre après.
Puis c'est difficile après ça de briser cette inertie-là.
Tout à fait.
Cette question d'interaction, on s'en est rendu compte progressivement, grâce à une des
parties de l'étude qu'on a menée, dont on a récemment analysé les résultats.
En fait, ça me tenait vraiment à cœur de permettre aux médecins qui ont répondu à
l'enquête sur laquelle on a basé la majorité de nos analyses d'avoir un espace pour
s'exprimer librement.
Donc, on avait posé une question ouverte à la fin de l'enquête qui était non obligatoire,
mais où tout simplement on demandait aux médecins directement, est-ce que vous avez une
expérience à partager quant à ce lien entre la culture professionnelle en médecine et
votre propre santé?
Et en fait on a été assez impressionnés parce qu'on a quand même eu plus de 220
témoignages parfois des médecins qui nous racontaient très très en détails leur historique
et leur vécu.
Et en psychologie on peut utiliser ce qu'on appelle de l'analyse qualitative, en
l'occurrence ici on a utilisé de l'analyse thématique,
qui permet de thématiser autour de grands thèmes ces témoignages.
En fait, ce qui est ressorti vraiment de cette analyse, sans rentrer dans les détails,
mais c'est vraiment que, oui, cette culture médicale existe, elle transmet une
représentation, une image du médecin qui doit être fort, dévoué, invulnérable, qui ne se
plaint pas, qui ne tombe pas malade, qui ne se fatigue pas.
Et cette représentation de la culture médicale va avoir toute une série de conséquences,
par exemple,
dans la normalisation de la violence dans certains contextes, par exemple en milieu
hospitalier lors de l'assistanat, notamment.
Mais il n'y a pas que cette culture médicale, cette culture médicale, interagit avec toute
une série d'autres niveaux d'influence pour finalement prédire la santé des médecins.
Par exemple des influences du niveau organisationnel, des cultures des organisations des
soins de santé, des organisations hospitalières par exemple vont aussi
renforcer cette culture professionnelle, cette culture médicale, les attentes des patients
par exemple, qui bénéficient de ce mythe du médecin qui est dévoué, qui ne tombe pas
malade, qui est en fait un super-humain, qui est un super-héros.
Parfois les proches aussi vont venir renforcer implicitement par des discours, par des
façons de voir la médecine comme étant très très prestigieuse et comme étant vraiment mise
sur un piédestal
et puis aussi des influences sociétales, exemple la féminisation de la profession, les
évolutions générationnelles comme je l'ai dit plus tôt qui viennent entrer un peu en clash
avec cette culture médicale.
Tout ceci va interagir ensemble, va venir renforcer souvent cette culture médicale et
renforcer l'impact que ça a sur la santé des médecins en termes de prendre soin de soi ou
justement ne pas prendre l'habitude de prendre soin de soi.
Puis, pouvez-vous me parler un petit peu plus de la méthodologie de votre étude ?
Oui, tout à fait.
En fait, on a fait le choix très tôt parce que j'avais conscience...
En fait, je n'avais pas envie d'être une énième chercheuse qui venait embêter des médecins
avec des enquêtes encore et encore, toujours plus longues, sans jamais que ces médecins,
qui souvent donnent de leur temps pour répondre à ces enquêtes alors qu'ils sont déjà
débordés, n'aient jamais de retour finalement sur les résultats de l'étude.
Donc dès le départ, j'ai voulu faire le choix de faire une grosse collecte de données
sur laquelle j'allais ensuite un peu organiser différents types d'analyses.
Mais le problème, c'est qu'on est obligé de faire des compromis aussi dans le sens où on
ne peut pas faire des enquêtes trop longues, on ne peut pas demander au médecin de
répondre pendant 40 minutes à une enquête, donc on avait conscience de tout ça.
Et donc, on a créé une collecte de données par enquête en ligne qui durait, je pense
qu'elle prenait un quart d'heure à compléter par les médecins et qui incluait d'abord des
questions qui venaient
caractériser le profil des médecins qui répondaient, c'est-à-dire âge, genre,
spécialisation, etc.
Ensuite, on a inclus 35 items, donc 35 questions qui essayaient de venir approcher ces
questions de la culture médicale dont je parlais plus tôt.
Ces items étaient des questions sur lesquelles les médecins pouvaient répondre sur une
échelle de fréquence de type degré d'accord de 0 à 5.
J'ai créé ces items sur base de la littérature et des échanges qu'on a eus avec les
médecins
et ensuite ils ont été revus et par des chercheurs et par des médecins.
Donc ça c'était pour la partie culture médicale.
Puis l'enquête inclut une série de mesures dont la majorité a été validée pour venir
explorer les aspects de la santé des médecins.
On a inclus une mesure validée du burn-out, de la dépression, mais on a aussi inclus toute
une série de mesures assez courtes pour investiguer des comportements de santé,
par exemple la tendance au présentéisme, donc le fait de travailler en étant malade, la
difficulté à demander de l'aide auprès d'un spécialiste, d'un médecin généraliste ou d'un
médecin spécialiste pour un problème de santé physique ou de santé mentale, la tendance à
l'autodiagnostic et l'auto-traitement aussi, et puis la consommation de toute une série de
substances, de l'alcool mais aussi des psychotropes.
Et puis comme j'ai dit, la dernière partie de l'enquête permettait aux médecins qui le
souhaitaient de s'exprimer librement à travers
une question ouverte.
Donc ça, c'était la collecte de données qui nous a permis de récolter des réponses de plus
de 1000 médecins francophones.
La majorité était belge, mais on n'a pas souhaité limiter le recrutement vu qu'on a fait
un recrutement d'un échantillon de convenance, ça s'appelle.
Juste, on a essayé de recruter le plus de médecins possible.
Et donc, on n'a pas forcément limité le recrutement à la Belgique.
Et donc, l'étude a été un peu relayée notamment en France via les réseaux sociaux et en
Suisse.
Je pense qu'il y a eu quelques réponses aussi du Canada, même si c'est une partie plus
faible.
Mais voilà, et on a eu quand même un échantillon assez représentatif en tout cas de la
population médicale en Belgique, avec une majorité de femmes.
Un échantillon qui était quand même relativement jeune, mais tant des médecins
généralistes que des spécialistes, et tant des assistants que des titulaires.
Donc en gros, on est parti d'un échantillon très solide, qui nous a permis de faire des
statistiques assez poussées.
C'est grâce à ça qu'on a pu développer, notamment dans la première recherche dont les
résultats ont été publiés récemment, une modélisation statistiquement très très solide de
cette culture médicale et puis de son lien au burn-out.
Et puis d'ensuite aller plus loin dans d'autres projets de recherche qu'on est en train de
mener pour le moment dans l'analyse des autres parties de ces résultats-là.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'aviez pas eu d'hypothèses trop a priori.
C'est-à-dire que vous n'avez pas mis les mots dans la bouche des répondants, puis vous
avez utilisé plus une approche exploratoire pour voir ce qui va ressortir dans un premier
temps, puis ensuite essayer de faire des corrélations.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment le point de départ qu'on a voulu adopter.
Même si on avait des hypothèses, on ne pouvait pas modéliser de manière très concrète ces
hypothèses parce qu'en fait, tout simplement, on ne savait pas comment...
On ne savait pas à quoi allait ressembler la modélisation de la culture médicale.
On avait toute une série de questions, donc on savait ce qu'elles souhaitaient approcher
ou mesurer, mais on ne savait pas comment cette modélisation allait ressortir au niveau
statistique.
C'est pour ça qu'on a utilisé des techniques d'analyse factorielle.
D'abord exploratoires, comme son nom l'indique, ces analyses exploratoires vont venir
modéliser les choses sur la base des données.
Ici, l'occurrence, aux bases des corrélations qui ressortaient de l'échantillon.
Et puis, on est venu, via des analyses factorielles confirmatoires, cette fois-ci, voir si
ce modèle tenait bien en l'appliquant à une autre moitié de l'échantillon.
Et en fait, on a vu qu'au niveau statistique, c'était très solide et donc ça nous a donné
confiance dans les résultats et pour ensuite établir le lien entre cette conceptualisation
finale de la culture médicale qu'on avait et les statistiques d'épuisement au sein de
notre échantillon.
À la fin, il y avait une régression hiérarchique pour aller reconfirmer tout ça.
Oui, c'est ça.
On a d'abord fait des simples corrélations entre ces dimensions de la culture médicale et
l'épuisement.
On a vu qu'il y avait vraiment des choses statistiquement significatives qui ressortaient
de manière très très claire, des tendances très claires.
Mais puis on s'est dit, est-ce que ces résultats tiennent toujours en contrôlant pour
toute une série de covariés, on sait de la littérature scientifique sur le burn-out des
médecins, qu'il y a des tendances claires en termes de risque d'épuisement plus important,
par exemple pour les femmes,
pour les médecins plus jeunes, pour les médecins de certaines spécialisations.
Et donc on voulait voir si les associations qu'on avait découvertes entre les dimensions
de la culture médicale et le burn-out tenaient toujours quand on contrôlait pour ces
covariés.
C'est pour ça qu'on a mené les régressions à la fin, qui effectivement nous indiquent que
toutes les dimensions de la culture médicale restent significatives dans la prédiction du
burn-out, même quand on contrôle pour ces covariés.
Puis les caractéristiques individuelles n'expliquaient pas la variance, c'est ce que je
trouvais vraiment fascinant.
Oui, ça, m'a beaucoup inquiété.
Je me suis dit, mince, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans mes données ?
Mais en fait, en replongeant, parce que j'étais effectivement très étonnée de la faible
proportion de variance expliquée dans le score de burn-out par les caractéristiques des
médecins, et en fait, en regardant la littérature, la majorité des études qui mènent de la
même manière des régressions trouvent des résultats similaires.
On voit des tendances, par exemple dans mon échantillon de 1000 médecins,
on voit typiquement que les femmes vont avoir des scores plus élevés d'épuisement, mais la
proportion expliquée est quand même faible.
Donc ça nous indique bien que oui, on observe des tendances propres au profil des
médecins, mais qu'il y a probablement bien plus qui peut être expliqué par d'autres
facteurs, notamment des facteurs d'ordre plus systémique, plus organisationnel que
simplement des facteurs d'ordre individuel.
Un des facteurs qui m'avait frappé, c'était le nombre d'heures travaillées aussi qu'on
pensait corrélées beaucoup avec le burn-out.
Souvent, quand moi-même je faisais du suivi individuel en psychologie, pour moi,
l'épuisement professionnel, c'était juste ça, c'était un épuisement, que j'ai trop
travaillé, puis que je suis arrivé au bout de mes ressources, puis de ma résilience.
Puis je vais aller en vacances, je vais partir recharger les batteries, je vais revenir,
puis,
évidemment, les choses n'ayant pas changé de mon côté ou dans la culture, je retombais
dans les mêmes patterns.
Puis là, c'est ça que ça vient confirmer de manière quantitative.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est assez intéressant parce que c'est assez simplificateur de penser que
l'épuisement, c'est simplement travailler trop.
En fait, c'est faux parce qu'il y a des médecins qui travaillent énormément, mais qui
trouvent énormément de sens dans leur métier et dans le fait de travailler autant et qui
ont toute une série de ressources qui font qu'ils ne s'épuisent pas et donc qui
compensent, par exemple, le nombre d'heures travaillées qui parfois est très, très
important.
L'épuisement, c'est bien plus que ça, c'est vraiment une perte de sens.
On ne trouve plus les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait.
Et pour des professions vocationnelles comme la médecine, cette perte de sens est hyper
lourde de conséquences parce que la majorité des personnes qui choisissent d'étudier la
médecine et de pratiquer la médecine le font pour des raisons très précises, notamment
d'aide à l'autre.
Mais la réalité du terrain aujourd'hui fait que cette question d'aider l'autre, elle passe
parfois au second plan, derrière des enjeux plus institutionnels, parfois financiers, etc.
et c'est cette perte de sens qui va être centrale pour comprendre l'épuisement, pas
uniquement le fait de travailler beaucoup.
Pour moi, personnellement, la perte de sens, ça a été le début de la fin.
Quand je n'étais plus capable de savoir pourquoi je me levais le matin pour faire ce
métier-là, alors que c'est un peu ce qui ressortait aussi dans les dimensions néfastes,
c'était que j'étais tellement engagé professionnellement, je ressentais finalement une
grande ingratitude de la part du système de savoir que moi, je m'engageais, que je donnais
beaucoup,
que je m'identifiais beaucoup à ce rôle de médecin-là qui était fusionné avec ma personne
individuelle.
Puis là, quand on perd le sens, tout s'effondre.
Oui, c'est super intéressant ce que vous dites et ça me fait penser dans les analyses
qu'on a menées de manière intéressante, en plus des dimensions de la culture médicale,
comme vous le disiez, il y a cette dimension du sens qui est ressortie.
Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans les questions qu'on a incluses dans
l'enquête, il y avait trois items propres à cet aspect de culture médicale qui venaient
questionner cette question du sens.
L'hypothèse que j'avais, c'était de me dire que ce sens venait peser, en fait.
Dans le sens où un médecin qui dit que son métier prend énormément de place dans sa vie,
dans ma tête, c'était vraiment potentiellement un facteur de risque pour l'épuisement.
Et quelque chose qui faisait partie de cette culture.
Alors, ce qui est ressorti au niveau statistique, c'est qu'on a d'une part une des trois
dimensions de la culture que j'ai appelées, commitment, donc l'engagement vers la
profession, et qui reprend
à la fois le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, que beaucoup de
médecins vivent, mais aussi la perception d'avoir fait énormément de sacrifices pour en
arriver là où on en est en tant que médecin, notamment sur la vie privée, et cette
question d'identité.
Donc à quel point est-ce que mon identité professionnelle et personnelle, comme vous
dites, sont fusionnées ou en tout cas sont indissociables ?
Et ça, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui ressort
beaucoup, de manière générale, quand on va en soirée, on rencontre quelqu'un,
les premières questions qu'on va poser c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Et pour des professions comme la profession médicale, c'est encore plus central étant
donné à quel point on travaille beaucoup, on a fait tous ces sacrifices comme je disais
des études longues, compliquées pour en arriver où on en est et donc cette identité
professionnelle elle va prendre beaucoup de place.
Ça, cette dimension de commitment fait partie de la culture médicale néfaste dans le
modèle tel qu'on l'a identifié et est corrélée vraiment à une augmentation du score de
burn-out.
Mais à côté de ça, ce qui est ressorti, c'est cette dimension du sens existentiel.
Donc à quel point est-ce que pratiquer la médecine contribue au sens que je donne à ma vie
?
Et initialement, moi, je pensais que ça allait faire partie de cette dimension de
commitment, mais en fait, ce n'était pas le cas.
C'était vraiment une dimension à part au niveau statistique.
Et elle collait moins avec ces dimensions de la culture médicale.
Et surtout, à l'inverse des autres, elle corrélait négativement au burn-out.
Donc ça voulait dire que quand le sens augmente,
le burn-out diminue.
Et ça, c'est assez logique parce qu'on définit parfois le burn-out professionnel comme une
perte de sens dans le métier.
Mais ce qui était aussi intéressant et c'est à ça que je voulais revenir, c'est que cette
dimension du sens, elle corrélait très peu avec les autres facteurs de la culture
médicale, mais elle corrèle quand même un peu avec ce commitment.
Et donc on voit qu'il y a un peu une espèce d'ambivalence ou quelque chose qui doit
vraiment rester en équilibre entre ne pas se sentir trop engagé
et trop dépendant de sa profession, mais quand même trouver du sens à ce que cette
profession contribue à ma vie de manière plus générale.
Donc, il y a un équilibre assez subtil je pense, mais on voit qu'on peut facilement
basculer d'un sens ou l'autre et que ça va déterminer beaucoup en termes de santé.
Puis la deuxième dimension que j'ai trouvée intéressante, c'était le mythe de
l'invulnérabilité, l'impression que comme médecin, puis ça, c'est quelque chose qui est
ressorti dans les témoignages, c'est qu'on n'a pas le droit d'être malade.
Puis j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit ça, puis j'ai vu des témoignages de personnes
qui avaient des maladies physiques,
des femmes enceintes qui avaient des infections virales, qui venaient à l'hôpital quand
même pour tourner les patients, avec un soluté au niveau du bras et qui étaient à
l'urgence le matin même, puis qui se disaient "Mon Dieu, je suis en train de voir les
patients, puis je suis probablement plus malade que ces personnes-là".
Mais pourtant, elles étaient là.
Oui, cette dimension-là, elle m'a beaucoup questionnée.
Dès que j'ai commencé à lire sur la question, je me suis dit qu'il y a quelque chose
d'assez particulier là.
Dans ma conception, c'est comme s'il y avait une incompatibilité entre le statut de
médecin et le statut de patient.
C'est comme si ces deux identités étaient mutuellement exclusives.
Et donc, c'est vrai que si je suis médecin, par définition, je ne suis pas patient.
Et les deux
sont vraiment difficilement réconciliables et puis c'est quelque chose qui est transmis
aussi encore une fois par les structures mêmes, les institutions de soins de santé, par
les facultés de médecine qui laissent entendre qu'on ne peut pas être malade, qu'on ne
peut pas rater un jour, qu'on ne peut pas rater des cours même si on est malade parce que
ça risque de nous mettre en retard par rapport à nos collègues.
d'être moins bien classés sur les concours, etc.
Donc dès le départ, ce discours est transmis.
Je pense qu'il n'y a aucun cours qui vient aussi expliciter l'idée chez les étudiants en
médecine qu'en tant que médecin à un moment donné on peut aussi tomber malade.
Et qu'est-ce qui se passe finalement dans ce double statut quand le médecin doit aller
lui-même chez un autre médecin ?
Il y a plein d'études là-dessus, super intéressantes, qui indiquent les dynamiques au
niveau psychologique qui se jouent et pour le médecin qui adopte le rôle de patient, mais
aussi pour le médecin qui doit soigner un confrère.
C'est vraiment hyper compliqué.
Il y a beaucoup des d'enjeux là-dedans qui se jouent.
Et puis encore une fois, le terrain, Les patients bénéficient de cette image de ce mythe
du médecin invulnérable.
Et puis il y a aussi, et ça il faut le souligner, les réalités du travail qui participent
à ça, la responsabilité légale et morale que les médecins ont envers les patients, mais
aussi envers leurs collègues.
Si je tombe malade, ma charge de travail retombe sur le dos de mes collègues.
Et comme je sais qu'ils sont aussi déjà en difficulté, et par solidarité, par
collégialité,
je n'ai pas envie d'imposer cette charge de travail en plus, donc je vais tenir bon.
Le problème, c'est qu'en adoptant ces mécanismes de coping, on continue à tirer sur la
corde jusqu'à ce que ça lâche et parfois, malheureusement, qu'on se retrouve dans des
situations en termes de santé beaucoup plus graves qui auraient pu être prises en charge
beaucoup plus tôt et même parfois de manière préventive pour éviter ensuite toute une
série de conséquences néfastes à plusieurs niveaux.
Ce que je trouve paradoxal, en fait, c'est que là, on parle des contingences systémiques,
finalement.
Ce sont les contraintes du système qui font en sorte que la manière dont on est organisé
dans notre pratique professionnelle, bien, effectivement, si moi, j'en fais moins, bien,
les autres vont devoir en faire plus.
Il n'y a pas moins de patients à voir.
La garde est à couvrir.
Il n'y a pas de moins de journées dans une année.
Donc, on a une imputabilité, puis un niveau de responsabilité qui fait en sorte qu'on n'a
pas le "droit
d'être malade".
Mais de ralentir pour prendre soin de soi, je me dis, ça ne devrait pas être
contradictoire avec le fait de soigner parce qu'effectivement, si on tire sur l'élastique
trop puis que finalement on tombe au combat, mais là, ce n'est pas un ralentissement de
l'offre de service qu'on va avoir, c'est une perte, puis une perte qui va être encore plus
lourde et difficile à remplacer.
Oui, tout à fait.
C'est si important et c'est ça qui est frustrant pour beaucoup de médecins.
Dans les témoignages que j'ai pu lire, beaucoup de médecins disent, mais on a bien
conscience qu'on doit prendre soin de nous.
Mais on ne peut pas mettre de limites et quand on met des limites, le pire, et c'est ça
qui est terrible et qui fait encore partie de ce curriculum caché, c'est que quand
certains médecins osent mettre des limites et dire, moi là j'ai besoin de temps pour moi,
j'ai besoin d'un congé,
ou si je suis en congé, je ne vais réellement pas travailler.
Je parle par exemple des médecins académiques qui, même s'ils sont en congé, vont
continuer à travailler et ne considèrent pas le fait de répondre à des mails ou de relire
des mémoires, etc.
comme faisant partie de leur recherche de travail.
Mais si !
Mais le problème, c'est que Le peu de médecins ou les médecins qui ont le courage
sincèrement d'imposer des limites et en fait de dire "J'ai besoin de temps pour moi, j'ai
besoin de prendre une pause, de prendre soin de moi", vont être mal perçus.
Ils vont être stigmatisés, souvent par leurs collègues.
Ils vont être perçus comme des moins bons médecins, comme des médecins plus faibles, des
médecins incompétents, comme des médecins qui n'appartiennent pas vraiment à cette
communauté prestigieuse du médecin fort.
Et ça, c'est terrible et c'est encore une fois lourd de conséquence, Cette stigmatisation
qui persiste et qui dépend directement de cette culture médicale, mais qui, comme vous le
dites, est renforcée par la réalité de l'offre des soins et par ce qui est demandé des
médecins au quotidien.
Ça, c'est évident.
Tout est vraiment interconnecté, mais...
J'ai vraiment envie de souligner ce courage, je trouve, qu'ont les médecins qui osent
exprimer soit leur parcours compliqué ou les difficultés qu'ils ont pu ressentir à un
moment donné, soit qu'ils sont capables de mettre leurs limites et d'avoir la résilience
aussi de faire face parfois à des discours extrêmement stigmatisants et parfois violents
de leurs collègues directs.
C'est impressionnant de voir à quel point ce système est parfois encore maintenu par des
discours très très violents et n'encourage pas du tout les changements vers une évolution
plus bienveillante, vers une culture plus bienveillante pour tous.
Et c'était la troisième dimension, exactement ça, la stigmatisation finalement.
c'est vraiment ce que beaucoup de médecins ont partagé dans leurs témoignages et qu'on a
retrouvé au niveau statistique, ce sont des attitudes stigmatisantes, on perçoit comme
moins, comme ayant moins de valeur les médecins qui s'épuisent à un moment donné, comme si
un médecin qui s'épuisait était un moins bon médecin ou un médecin qui n'est pas capable
de tenir bon.
Et ces discours implicites font partie de cette culture, font partie de ce curriculum
caché.
Et en fait, ils commencent à être instaurés hyper tôt sur les bancs d'université.
Vraiment.
Je ne sais pas si au Québec on a aussi parfois entendu ce type de discours, mais moi dans
mon environnement direct de proches qui ont étudié la médecine, mais aussi dans les
témoignages que j'ai recueillis, ce fameux discours de dire le premier jour de cours,
regardez à droite et à gauche, à la fin, vous ne serez plus qu'un sur trois.
Il entraîne directement une mise en compétition.
Ça, plus les concours d'entrée, plus les concours de spécialisation, en fait, on transmet
ce message qu'il ne faut pas uniquement être bon, il faut être toujours le meilleur pour
arriver où on veut arriver en médecine.
Et tout ce système qui est développé dès la première année des études ne fait que se
renforcer au fur et mesure des années et après on s'étonne que les médecins finissent par
adopter ces manières de penser parce que c'est leur seule manière de survivre dans ce
système.
Oui, bien c'est ça, c'est toujours une question de survie finalement.
Je trouve qu'ensuite, quand on additionne tous ces facteurs-là, toutes ces dimensions-là,
on explique finalement un pourcentage significatif de la variance au niveau du burn-out.
Là, je voyais jusqu'à 30 %.
jusqu'à 30%.
Alors ce qui est intéressant, c'est que, et c'est important pour moi de le dire, c'est que
ces 30 % incluent aussi le sens.
Et que le pourcentage de variance expliquée du burn-out était quand même moins
significatif sans le sens, si on reprenait uniquement cette culture médicale néfaste.
Donc ça montre que le sens contribue énormément à la prédiction de l'épuisement.
Et nous, les hypothèses qu'on fait en fait, mais
notre design de recherche ne permet pas de l'étudier pour le moment parce qu'on a fait une
étude cross-sectionnelle, donc on ne peut pas du tout dire que les associations qu'on a
mises en évidence sont des associations causales.
Mais l'hypothèse que j'ai eue en voyant ces résultats, c'est quand même probablement que
le sens vient compenser le poids de la culture médicale sur le dos des médecins.
Donc que cette culture médicale qui pèse sur le dos des médecins va venir être atténuée
tant que les médecins continuent à trouver du sens dans leur profession.
Donc je pense que cette dimension-là, il faut vraiment continuer à l'explorer à travers
les recherches et comprendre comment est-ce qu'on peut maintenir finalement un sens
important dérivé de la profession parmi les médecins.
Quelle a été la réception par rapport aux forces de votre étude?
Alors, j'ai envie de dire qu'elle a été perçue avec beaucoup d'ambivalence sur le terrain.
En fait, à chaque fois que je présente les résultats, j'ai des retours hyper positifs, des
médecins qui viennent me voir et qui me remercient de mener des recherches sur ces
thématiques, qui me disent à quel point ça leur fait du bien de voir finalement des
chiffres mis derrière des ressentis que eux ont.
Ils me disent à quel point ce que je fais fait du sens et surtout cette mise en
perspective d'une culture médicale qui est interdépendante avec des facteurs systémiques
plus larges, bien certains médecins viennent me voir en disant, mais il faudrait que tu
viennes me présenter ça au gouvernement, au ministère de la Santé pour que ça puisse
amener à une prise de conscience.
Donc ça c'est génial.
Et une partie de ces réactions provient notamment de maîtres de stage, donc de
superviseurs qui encadrent des plus jeunes parce que de plus en plus j'ai été invitée à
présenter,
ici en Belgique, dans les quatre grosses universités francophones, notamment qui ont des
programmes en médecine.
Donc ça pour moi, c'est super stimulant.
Je dois quand même avouer que j'ai rencontré aussi pas mal de résistance de la part de
certains médecins, mais qui parfois étaient des attitudes hyper violentes et qui venaient
attaquer mes travaux de recherche, voir attaquer directement ma personne derrière pour
remettre en question tout ça.
Ça a été dur parfois de recevoir ces critiques.
En tant que chercheuse et chercheur, il faut apprendre clairement à dissocier les
critiques qu'on fait sur notre travail, des critiques qui portent sur notre personne.
Ce n'est pas toujours si évident, surtout quand on s'implique autant dans les travaux
qu'on mène.
Mais avec du recul, je pense que ces marques de résistance sont une expression même de
cette culture que je dénonce.
Exactement.
Et donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant de se dire mais qui sont ces
médecins qui résistent ?
Et ce qu'on m'a notamment renvoyé dans certaines présentations c'est que ces médecins qui
résistent les plus sont parfois les médecins superviseurs les plus problématiques qui
mettent le plus en difficulté les plus jeunes et qui probablement ont eux-mêmes été
éduqués à un système hyper rigide.
Donc en termes de réflexion et de perspectives c'est quand même assez intéressant de
prendre conscience de ça.
Et puis...
Parfois aussi des réactions plus compliquées quand on essaye de proposer des évolutions,
notamment en faculté de médecine.
Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, je pense qu'il y a énormément à
faire dans les facultés de médecine.
Quelque chose que j'adorerais développer, par exemple, c'est développer des cours, je
pense qu'on manque beaucoup de ça, en tout cas en Belgique, des cours d'humanité médicale.
Je pense qu'une piste vraiment à explorer et qui est évoquée beaucoup dans la littérature,
c'est de venir faire témoigner des médecins qui sont des médecins, j'ai envie de dire,
avec une aura professionnelle importante, c'est-à-dire des médecins qui ont une belle
carrière derrière eux, qui sont excellents dans leur domaine, qui ont un certain prestige.
En fait, on a besoin de ce degré de prestige, d'aura pour que ces interventions soient
efficaces, mais que ces médecins puissent témoigner de vulnérabilité qu'eux auraient vécu
dans la profession à un moment donné.
De dire, on peut être un excellent médecin, à un moment donné être mis en difficulté pour
x y raisons et puis de mettre en évidence des solutions qui ont été développées pour faire
face à ces difficultés.
Ça, c'est quelque chose que je souhaiterais beaucoup développer, mais on rencontre quand
même encore de la résistance encore une fois sur le terrain quant à la mise en place de
ces interventions, pour des arguments que je peux entendre partiellement, notamment le
fait que ce sont déjà des programmes hyperchargés.
Et d'ailleurs quand je donne des cours en bac 1 chez nous de médecine, j'ai eu une fois
une étudiante qui est venue me voir à la fin d'un cours en me disant, je suis désolée que
si peu d'étudiants étaient présents, mais sachez que ce n'est pas dû par manque d'intérêt
pour votre thématique, c'est juste qu'à un moment on est obligé de faire des choix.
Et avant les examens entre venir assister à un cours de psychologie et étudier son cours
d'anatomie, bien le choix est vite fait.
Et c'est hyper entendable, mais encore une fois c'est la structure même qui impose ces
choix que les étudiants font et qui malheureusement dès le départ vont faire que les
étudiants intègrent le message que les sciences humaines, la psychologie et le prendre
soin de soi en tant que médecin et apprendre ça c'est moins important que l'anatomie alors
bien sûr qu'apprendre l'anatomie en tant que futur médecin c'est essentiel, mais je pense
qu'il faut repenser l'organisation des facultés de médecine en tout cas je parle pour chez
nous.
De réfléchir, ça c'est un exemple typique de ce curriculum caché, réfléchir à la manière
dont on organise les choses et au message que cette organisation transmet aux étudiants en
médecine.
Parce que c'est sûr que l'inertie du statu quo va toujours être le chemin le plus facile à
emprunter.
Puis la résistance au changement, je trouve ça très dommage que vous ayez eu des
témoignages et des critiques aussi violentes.
Cependant, je pense que ça donne un certain levier par rapport à la problématique que vous
tentez exactement d'expliquer.
Puis je pense que ce levier-là,
devrait nous servir collectivement à poser des gestes concrets pour changer les choses
pour les gens qui voudront bien l'entendre.
Oui, je suis super d'accord.
Je suis hyper hyper d'accord et je pense qu'il faut avoir la capacité de prise de recul
pour justement voir ces critiques et ces perspectives parfois violentes comme des leviers
d'action.
Maintenant, ce qui est extrêmement, je pense, compliqué, c'est que si on espère mettre en
place des changements effectifs et durables dans la profession, ces changements doivent
être portés...
En fait, c'est une responsabilité individuelle et collective.
Et collective, dans le sens où je pense que les médecins doivent ensemble se mobiliser
pour transmettre ce message qu'il y a des choses qui doivent changer.
Chez nous en tout cas, je pense que ce changement commence déjà à se faire.
Les assistants chez nous, les plus jeunes médecins se mobilisent énormément pour faire
évoluer positivement par exemple leurs conditions de travail.
Au niveau légal, il y a énormément de choses qui ont évolué ces dernières années par
rapport notamment par exemple aux horaires de travail, à la rémunération.
Et donc on voit qu'il y a déjà des changements en cours et que des choses qui étaient
tolérées avant ne le sont plus aujourd'hui.
Chez nous, a eu récemment aussi des assistants qui ont osé témoigner, notamment dans des
reportages qui ont été diffusés à la télévision, du harcèlement qu'ils ont vécu pendant
tout leur assistanat.
Et ça, ce sont des choses qui auraient été inimaginables il y a encore dix ans, de venir
témoigner et de parler ouvertement de ça, parce qu'il y avait ce, comme vous dites, ce
statu quo et cette culture du silence, une omerta très très forte.
Le fait que des reportages sur ces questions sortent, pour moi, c'est déjà un indicateur
d'une évolution qui est en cours.
Et je pense qu'il faut continuer à porter ça.
Et je suis persuadée que pour continuer à faire évoluer les choses, on a besoin de
personnes charismatiques, encore une fois, qui sont prêtes à porter ce message et à
travailler collectivement pour faire évoluer les choses, en fait, j'ai envie de dire à se
mouiller, vraiment oser prendre le risque, quitte à ce qu'elles soient critiquées encore
une fois, on revient ce qu'on a dit plus tôt.
sur leur réputation, sur...
Voilà, qu'il y ait des critiques qui soient faites de manière plus ou moins explicites,
mais que ces médecins osent à un moment donné transmettre le message que ce qui se passe
sur le terrain, ce n'est pas OK.
Je pense par exemple à des patrons qui puissent prendre la défense d'assistants quand ils
voient que ces assistants sont encore victimes de harcèlement de toutes sortes de la part
de leurs collègues directs.
Il y a quand même vraiment des réalités...
Et on le sait, ça, la littérature, elle l'indique très clairement.
Si on reprend la question du stigma, le fait d'avoir des modèles de rôle charismatiques
qui viennent changer les choses, c'est une des formes d'influence les plus puissantes.
Vraiment, je pense que c'est là-dessus qu'on doit jouer, notamment.
Je dis souvent, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis si on veut avoir des résultats
différents, va falloir faire les choses différemment.
Puis il faut arrêter de penser ou d'espérer que le système change pour prendre soin des
soignantes et des soignants.
Donc je pense que c'est un peu notre responsabilité de faire en sorte qu'on mette les
conditions gagnantes pour amorcer ce changement-là.
Puis je pense que l'endroit où commencer, c'est par soi-même.
Je vous dirais que c'est exactement ça la démarche un peu derrière ce balado-là.
En disant, regardez, j'ai eu mes difficultés, je ne prétends pas avoir les réponses, je ne
suis pas ici pour donner des leçons, mais c'est possible d'aller mieux, puis vous n'êtes
pas seuls.
C'est une initiative super importante, ce partage de vulnérabilité, d'expérience et de
témoignage.
C'est ce genre de projet dont on a besoin et qui participe clairement à ce changement.
C'est génial que ce genre d'initiative soit développée vraiment.
Puis, au niveau des solutions, dans vos recherches, est-ce que vous prévoyez faire des
études plus prospectives?
J'aimerais beaucoup, notamment en fac de médecine.
Moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de développer davantage en éducation
médicale chez nous.
J'ai certaines idées comme celles que j'ai évoquées, le fait de développer des cours
vraiment centrés autour de ces questions.
Et d'ailleurs, j'ai eu la chance ici pour toute une série de raisons d'intervenir dans
certains cours, notamment en bachelier de médecine
et les étudiants m'ont dit à quel point ces cours qui parlaient de la culture médicale
alors que ces étudiants sont en tout début de parcours, étaient parlant pour eux et
venaient déjà amorcer toute une série de réflexions.
Et moi j'ai été impressionnée parce que j'ai voulu rendre ces cours très interactifs de la
réceptivité des étudiants et des questionnements qu'ils avaient déjà très tôt.
Donc je suis persuadée qu'il y a plein de choses à faire là-dedans et que suivre des
étudiants qui auraient suivi ce type de cours en fait pendant leur parcours et voir
comment ça affecte leur perception de la culture médicale
et in fine leur santé, mais aussi avoir des cours de sensibilisation justement à ces
problématiques de santé mentale en médecine.
Des cours je pense qui devraient avoir lieu dès le début du parcours, mais qui devraient
aussi avoir lieu avant les premières expériences de stage auxquelles on pourrait
sensibiliser aussi justement à cette importance du modèle de rôle et à cette importance de
ce qui est transmis par exemple sur le terrain pendant les expériences de stage.
Ça ce sont tous des projets que j'aimerais développer.
Maintenant, je ne vous cache pas que pour développer ces projets, encore une fois, il faut
qu'il y ait des opportunités qui se présentent et il faut pouvoir être entouré des bonnes
personnes au bon moment.
Pour être hyper honnête, même si j'ai des promoteurs qui me soutiennent à fond dans ces
projets, je suis hyper isolée.
Dans cette thématique de recherche, y a très peu de...
Dans le labo auquel j'appartiens, il n'y a aucun chercheur qui travaille là-dessus.
Et en Belgique, très peu de chercheurs qui travaillent sur ces questions.
Le fait d'être isolée rend la mise en place de ces projets plus compliquée.
Et donc j'essaye de développer des collaborations à l'international, voire d'aller
développer des choses ailleurs pour revenir avec un bagage plus solide en Belgique,
notamment pour gagner en légitimité auprès des personnes qui pourraient donner une
ouverture à ces projets.
Voilà, ça c'est un peu tous les enjeux auxquels je suis confrontée pour le moment, qui
limitent un peu le développement d'autres projets que je souhaiterais développer.
Mais c'est clair qu'il y a toute une série d'idées qui n'arrêtent pas de grandir dans ma
tête quant à des choses qui devraient être mises en place du point de vue plus individuel
au point de vue plus systémique.
Je crois vraiment que sensibiliser, visibiliser, mettre en lumière et échanger autour de
ces thématiques, c'est déjà une première manière de faire changer les choses.
C'est pour ça que des opportunités comme celle-ci de venir partager mes recherches, pour
moi, c'est déjà une chouette manière
d'essayer de contribuer à ce changement.
C'est un peu la vision que j'ai, c'est d'y aller un peu via un modèle de soins par palier.
C'est qu'on commence au niveau des individus avec l'auto-gestion, l'auto-soin, pour
premièrement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, essayer un peu de
décoder cette voix intérieure-là qui nous parle intuitivement, mais qu'on a appris à
taire.
Par la suite, c'est le soutien entre pairs, puis le mentorat, puis je pense que ça brise
ce silence-là.
Ça augmente le sentiment de cohésion, puis ça vient un peu parfois redonner du sens.
Aussi quand on connecte avec la souffrance des autres, avec l'humain qui est avec nous,
bien ça vient un peu réitérer pourquoi je fais ce métier-là, pourquoi j'ai choisi cette
carrière-là, puis ça me redonne
l'énergie de continuer.
Le dernier palier, c'est de reconnaître que je suis rendu à un point où j'ai besoin d'aide
professionnelle, puis que là maintenant, il faut que je consulte un psychologue, un
psychiatre pour pouvoir vraiment, comme je dis, on commence là où on peut commencer, puis
ça va commencer avec soi-même.
Moi, je ne pourrai pas contrôler mes collègues, je ne pourrai pas contrôler les cibles
gouvernementales ou les exigences du système,
mais je peux modifier ma perception que j'ai de ces contraintes-là.
Oui, c'est super intéressant et je pense vraiment que partir de ça, partir de soi, je
crois que d'une part, ça redonne un sentiment de contrôle à l'individu quand parfois on
est confronté à ces discours qui n'arrêtent pas de nous dire que c'est le système, comme
vous disiez, qui doit changer, mais on contribue à ce système.
Le système, il est fait des individus qui le constituent.
Et donc, faire le choix à un moment donné de
ne plus être la victime de ce système et de commencer soi-même à mettre en place des
choses pour soi, je pense que ça permet aux médecins qui le font de reprendre un sentiment
de contrôle justement sur cette réalité.
Et puis comme vous disiez de fonctionner par paliers, et le premier palier pour moi est
déjà si intéressant d'ouvrir en fait la discussion sur ce partage de vulnérabilité, c'est
quand même quelque chose qui est très rare en médecine alors qu'on est dans une profession
hautement humaine et donc émotionnelle dans laquelle il y a
toute une série d'enjeux qui font que les médecins peuvent être mis en difficulté et que
tous les jours ne seront pas faciles, mais le fait qu'il n'y ait aucun espace pour aborder
ces difficultés avec...
Je parle bêtement des étudiants, je vois certains étudiants en médecine qui parce qu'ils
sont en compétition avec leurs amis les plus proches pour avoir la même spécialisation
pour laquelle le nombre de places sont limitées ne vont plus autant partager, ne vont plus
autant échanger et vont se distancier.
C'est quand même
hyper terrifiant de se dire ça et donc réinstaurer cet espace de partage sur le terrain et
le maintenir en fait pendant toute la carrière des médecins à travers des espaces
d'intervention, de discussion ou simplement à travers une prise de café avec un collègue
où on demande tout simplement comment tu vas.
Je pense que c'est quelque chose qui est une habitude qui se perd mais qui peut pourtant
déjà tellement, tellement changer les choses et aussi de se dire en tant que médecin qu'à
un moment donné on peut tendre la main
vers un collègue et peut-être que ça va changer énormément de choses pour cette personne
qui à un moment soit on le voit ne va pas bien, soit justement le masque très très bien,
mais qui après pourrait être mis beaucoup plus en difficulté et qu'on culpabilise parce
qu'on n'a pas pu tendre cette main à temps.
Il y a tous ces éléments-là aussi qui jouent et donc ça demande du courage, ça demande
d'être vulnérable et d'être honnête avec soi-même aussi.
Mmh.
Mais ce sont des petits gestes qui peuvent réellement changer le quotidien de certaines
personnes et qui progressivement, s'ils sont maintenus, vont participer à cette évolution
d'une culture vraiment.
Ça, j'en suis persuadée.
On va avoir plusieurs soignantes, soignants, des proches qui vont écouter ce balado.
Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Pour les soignants concernés, et je pense que certaines des thématiques qu'on a abordées
ici ne concernent pas uniquement les médecins, mais concernent aussi d'autres professions
soignantes qui sont concernées par les mêmes réalités et partiellement par la même
culture.
Moi ce que j'essaye toujours de transmettre comme message, c'est...
En fait, je prends souvent la métaphore du masque à oxygène dans les avions.
Quand on donne les instructions aux passagers, on dit toujours mettez d'abord votre propre
masque à oxygène avant de mettre celui
d'un enfant ou d'une personne vulnérable à côté de vous.
Et je trouve que cette métaphore est très parlante pour la question dont on a parlé
aujourd'hui.
En tant que médecin, savoir d'abord mettre son propre masque à oxygène avant de venir
soigner les patients et d'avoir conscience que pour être un bon médecin d'un point de vue
clinique, on doit aussi pouvoir être en bonne santé, prendre soin de soi et aussi montrer
cet exemple justement à nos patients.
C'est quelque chose qui paraît très évident, mais qui en fait sur le terrain n'est pas si
simple à appliquer.
Donc ça c'est un message que j'aimerais transmettre pour les soignants.
Et puis pour leurs proches, il y a un peu cette ambivalence pour moi du rôle des proches
parce que les proches des médecins qui ne sont pas membres du monde médical vont être
hyper importants pour parfois venir pallier et compenser des effets néfastes de cette
culture médicale dont les membres n'ont plus conscience.
Et donc en tant que proche, pouvoir tirer la sonnette d'alarme à temps, en disant à son
proche qui est médecin, "Mais tu ne te rends pas compte de la réalité dans laquelle tu es
et des choses que tu acceptes au quotidien?" Je pense par exemple au harcèlement, c'est
quelque chose qui était ressorti dans les témoignages qu'on a pu voir d'assistants chez
nous qui partageaient leur expérience d'harcèlement, qui expliquaient, c'est quand j'ai
parlé de ce que je vivais et des discours que j'entendais et de ce que j'acceptais au
quotidien à mes proches
qui m'ont dit, "Tu ne te rends pas compte, ce n'est pas normal ce que tu vis." Et donc, je
pense vraiment que les proches qui sont en dehors du monde médical, et qui parfois ne
comprennent pas la réalité dans laquelle les médecins se trouvent, ont un rôle essentiel à
jouer pour venir à temps compenser potentiellement les effets de cette culture et pouvoir
ouvrir aussi à cette discussion, de mettre en évidence certaines choses qui semblent être
des habitudes, des normalités pour les médecins, mais qui en fait ne le sont pas du tout.
Mmh.
Je pense que les proches en ce sens-là ont aussi un rôle central à jouer pour participer à
des prises de conscience.
C'est sur que, changer une culture, c'est quelque chose qui se fait à la racine et qui va
prendre des décennies, même, probablement.
Ma dernière question pour vous, si vous pouviez parler à Emilie, au tout début de son
parcours, début vingtaine, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire?
J'aimerais lui dire, fais-toi confiance.
Fais-toi confiance et fais confiance à la vie parce qu'elle est souvent très très bien
faite.
En tout cas, merci énormément pour la rencontre.
Je pense que ça vient mettre en lumière des choses qu'on ressent tous et toutes
intuitivement, qu'on constate empiriquement, mais que là on peut vraiment évaluer de
manière quantitative.
Pour bien connaître les rouages de notre système, puis comment fonctionnent et
réfléchissent nos gouvernements, on veut souvent des données, puis des données souvent
chiffrées.
Puis je pense que votre étude vient nourrir vraiment la réflexion, puis comporte assez de
nuances pour que l'on puisse avoir l'humilité, je pense, comme communauté, de se dire
comment on peut faire les choses autrement?
...
Réalisons qu'on fait partie de la problématique, mais que ce n'est pas une fatalité pour
autant.
Je pense qu'on a du pouvoir plus qu'on ne le pense.
Je pense que comme professionnels, on a la chance de pouvoir s'autoréguler dans notre
pratique.
Alors, je pense que notre bien-être mental devrait devenir une priorité.
Puis je pense que c'est possible,
que ça va nécessiter des efforts, mais je pense que des personnes comme vous viennent un
peu cimenter les bases de ce qui pourrait être une approche vraiment innovante.
C'est super gentil, ça me touche beaucoup, merci beaucoup.
Puis en tout cas, on pourra peut-être trouver l'occasion de rediscuter, mais je vous
remercie encore pour la rencontre d'aujourd'hui.
Merci à vous, c'était super chouette.
Un grand merci.
Créateurs et invités