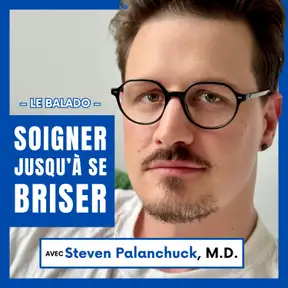Épisode 0.14 : Survivre dans une tempête sans boussole – Cloé Beaulieu, étudiante à la maîtrise et professionnelle de recherche
Ce que les infirmières mentionnent aussi, c'est qu'elles ce sont senties comme en temps de
guerre où tout le monde est en mode survie, puis chacun fait un peu pour soi.
y a quand même des milieux où tout le monde était tellement en mode survie que c'était un
peu : "Moi, toute l'énergie que j'ai, je vais la garder pour moi parce que j'en ai pas
pour d'autres choses.
Je viens travailler, puis je me couche, je reviens travailler, puis c'est tout."
C'était comme une espèce d'alerte, de mode survie pour les infirmières, versus d'autres
qui sont peut-être restées dans leur milieu.
Bonjour et bienvenue à "Soigner jusqu'à se briser".
J'espère que vous allez bien.
Je m'appelle Steven Palanchuck.
Et aujourd'hui, pour ce quatorzième épisode hors série, je vous présente ma conversation
avec Cloé Beaulieu, étudiante à la maîtrise et professionnelle de recherche.
Cloé est étudiante à la maîtrise à la recherche en sciences de la santé à l'Université de
Sherbrooke sous la direction de Pre Marie-Eve Poitras et Pr Christian Rochefort.
Elle a aussi un parcours en travail social, ce qui a nourri son regard à la fois humain,
clinique puis critique sur les milieux de soins.
Dans cet épisode, elle nous parle des trajectoires vécues par les infirmières et les
infirmiers pendant la pandémie de COVID.
Elle met en lumière ce qu'on leur a demandé, les formes d'adaptation qu'ils ont dû
développer, puis les marques que tout ça a pu laisser.
On discute aussi des mécanismes de défense, de la fameuse résilience, de la culture du
soin et de tout ce qu'on a peut-être normalisé trop vite sans mesurer vraiment les effets
à long terme.
Donc, j'espère que vous allez apprécier la discussion, puis sur ce, je vous souhaite une
bonne écoute.
Première question pour toi, pourquoi t'as accepté de participer à ce projet de balado?
Oui, en fait, je travaille depuis un certain temps sur un projet qui a été créé pour aller
voir un peu la perception, la trajectoire du personnel infirmier pendant la pandémie ici
au Québec.
Puis en fait, moi, je me suis intéressée aussi plus particulièrement aux stratégies
d'adaptation que les infirmières et les infirmiers ont prises
pour s'adapter à toutes les conditions de travail qui ont changé, puis aussi aux
expériences qui avaient le potentiel d'être traumatisantes, qu'ils ont vécues pendant
cette période-là.
Puis je pense que l'aspect aussi plus individuel, c'est souvent oublié quand on parle de
comment ça s'est déroulé, la pandémie.
Souvent on s'intéresse à comment les organisations ont géré ça, aux impacts sur la
population, mais des fois un peu moins
à la réalité des personnes qui étaient en place pour nous soigner pendant cette
période-là.
Je voulais venir partager un peu le résultat de mon projet et du vécu que j'ai pu avoir
comme travailleuse sociale pendant la pandémie.
Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là particulièrement?
En fait, moi, j'ai fait un changement de carrière moi-même pendant la pandémie.
Ma trajectoire de carrière a changé.
Je suis venue travailler à temps plein en recherche, à peu près vers la fin de la pandémie
en 2022.
Puis, avec l'équipe avec laquelle j'ai été amenée à travailler, il y avait un projet qui
était en cours, qui était en démarrage sur les trajectoires des infirmières.
Puis quand j'ai décidé d'aller compléter une maîtrise puis que je devais choisir un projet
qui m'interpellait, c'est ce projet-là sur lequel j'avais travaillé, sur lequel j'avais
aidé à organiser les entrevues qui m'intéressait le plus.
De par mes intérêts personnels, mais aussi de mon background dans le travail social,
j'avais envie d'aller voir comment les gens s'étaient adaptés, c'était quoi leur
expérience, comment on pouvait mieux les aider.
Puis, j'avais une belle opportunité de m'intégrer justement à un plus gros projet qui
était déjà en marche, qui me permettait de faire peut-être un projet de plus grande
envergure pour un étudiant à la maîtrise qui commencerait un projet de zéro.
Je trouve ça intéressant parce que j'en discutais avec Dre Mélissa Généreux qui est
spécialiste en santé publique, entre autres sur l'étude des impacts psychosociaux des
grandes crises sur la santé des populations, puis l'étude de la population soignante a
souvent été dans notre angle mort.
On s'est beaucoup intéressé à l'impact
de la pandémie sur la population elle-même, mais les soignantes, les soignants qui étaient
aux premières lignes, souvent c'était moins documenté.
En tout cas je suis reconnaissant qu'il y a des gens comme toi qui s'intéressent à ce
sujet-là.
Pour qu'on puisse premièrement comprendre un peu plus.
Tu sais, là, ça fait déjà cinq ans, la pandémie, donc on commence à avoir un peu plus de
recul.
Puis ensuite, espérer apprendre pour la suite des choses, finalement.
C'est sûr que l'objectif de nos projets de recherche, c'est toujours de pouvoir
s'améliorer.
Améliorer les moyens qu'on va prendre la prochaine fois, comment on peut prévenir, aider,
mais aussi réparer par après s'il y a des choses à faire.
C'est sûr que pour moi, l'équipe avec laquelle je travaille, c'était une priorité d'aller
voir la réalité des équipes soignantes.
Veux-tu me parler un petit peu plus de ton projet spécifiquement?
Qu'est-ce que vous avez étudié?
C'était quoi votre méthode?
Oui, mais en fait, pour mettre en contexte mon projet à moi, je vais parler un peu du gros
projet.
C'est une analyse des trajectoires des infirmières pendant la pandémie.
C'est un projet qui est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada.
Puis, ce sont mes directeurs, Marie-Eve Poitras et Christian Rochefort, qui ont obtenu
cette subvention-là puis qui ont monté ce projet-là à la base.
C'est un projet
qui visait à aller étudier la population infirmière québécoise.
Puis il y avait deux volets, un volet de questionnaire pour aller voir un peu le nombre de
réaffectations, évaluer aussi l'état de santé psychologique, physique pendant la pandémie,
puis après.
Il y avait un volet aussi d'aller faire des entrevues.
Donc, les personnes infirmières qui répondaient aux questionnaires avaient l'opportunité
de laisser leur contact
pour participer à une entrevue semi-dirigée, donc une entrevue en ligne comme on fait en
ce moment, d'une durée d'environ une heure à une heure trente, où on allait faire tout le
parcours de vie de ces infirmières-là.
On partait avant la pandémie, puis on terminait dans l'ici et maintenant, quand on faisait
l'entrevue.
Donc on pouvait voir l'évolution de la personne dans le temps, en fonction des moments de
la pandémie, tant au niveau professionnel que personnel.
Puis on allait voir aussi
ce que la personne voudrait voir changer, c'est quoi les solutions qu'elle envisagerait,
puis comment elle aimerait être mieux préparée pour vivre une crise comme on a vécu pour
la pandémie.
Je me mets à la place de ces personnes-là.
C'est le fun d'avoir des gens qui s'intéressent à cette trajectoire-là, puis de se sentir
entendus, puis qu'on puisse prendre vraiment un moment de parler de son vécu et j'imagine
peut-être des motivations aussi qui ont fait en sorte que ces gens-là ont choisi la
profession infirmière.
Oui, on allait vraiment, on partait des motivations de base de pourquoi on a choisi la
profession infirmière, puis on se rendait, des fois les gens avaient complètement changé
de carrière aussi à la fin des trajectoires.
Nous, on a identifié cinq trajectoires pendant la pandémie, donc les personnes qui ont
maintenu leur poste, qui n'ont pas eu de changement de poste, qui ont peut-être été prêter
main forte dans des milieux de crise, mais qui grossièrement sont restées dans leur poste.
Puis ça a été plutôt stable au niveau professionnel, "stable", mais à travers tous les
changements qu'il y a eu.
Bref, il n'y a pas eu de grands changements de carrière.
On avait la trajectoire 2 qui était plutôt les gens qui ont changé volontairement de
poste.
Donc, ils sont restés à l'emploi de l'employeur pour lequel ils étaient pré-pandémie, soit
dans le réseau de la santé ou des milieux privés.
Mais ils ont pris un poste différent.
Dans cette trajectoire-là, on avait beaucoup
des personnes infirmières qui ont, par exemple, pris un poste peut-être qu'on pourrait
considérer qui leur permet un avancement de carrière, conseillère en soins ou des postes
en GMF peut-être avec des conditions qu'elles considéraient comme étant meilleures ou plus
adaptées à leur vie.
Puis on avait la trajectoire 3 qui était les personnes qui ont été réaffectées ou
délestées contre leur gré.
Donc là, nos infirmières qui étaient forcées d'aller travailler dans des milieux de
travail où il y avait une pénurie ou une augmentation des cas.
Donc majoritairement des gens qui sont allés travailler en zone rouge, sur les étages
COVID, mais aussi dans les centres de personnes âgées pour aller prêter main forte pendant
la pandémie.
Pour ces personnes-là, il y a eu souvent plusieurs réaffectations, donc plusieurs milieux
pendant la pandémie.
Peut-être que la première affectation était volontaire, mais par la suite, ce qui
caractérise cette trajectoire-là, c'est que c'est devenu involontaire.
Puis, on a la trajectoire suivante, la trajectoire 4, que nous on a appelée, qui sont les
gens qui ont démissionné.
Donc, ce sont majoritairement des plus jeunes personnes infirmières qui étaient plus
récemment diplômées, qui ont quitté pour les agences, entre autres, mais aussi d'autres
milieux, mais majoritairement les agences,
pendant la pandémie.
C'est souvent des gens qui ont été réaffectés aussi contre leur gré avant de démissionner.
Puis on avait notre dernière trajectoire, la trajectoire 5, qui était des personnes qui
sont revenues à l'emploi du réseau de la santé pendant la pandémie, donc majoritairement
des personnes retraitées qui sont revenues via "Je contribue" pour prêter main forte aux
centres de vaccination, en gestion, en dépistage et parfois aussi dans les milieux
cliniques.
C'est vraiment intéressant parce que là j'imagine qu'en fonction de la trajectoire tout le
monde avait un peu des façons différentes de réagir puis de s'adapter à la crise qu'était
la pandémie.
C'étaient quoi les sentiments qui dominaient?
Oui, en fait, c'est ça.
Moi, mon projet plus spécifiquement, c'est que je me suis intéressée vraiment aux
stratégies d'adaptation individuelle.
Qu'est-ce que les gens ont pris comme stratégies pour s'adapter?
Puis en fait, c'est sûr que pour toutes les trajectoires, il y a des choses communes qui
reviennent.
Majoritairement, les infirmières et infirmiers se sont sentis un peu délaissés par le
système.
Ils ont senti qu'ils manquaient d'informations, qu'ils n'avaient pas suffisamment tous les
outils ou tous les éléments de protection nécessaires aussi pour intervenir pendant la
pandémie.
Mais il y a quand même des choses spécifiques à chaque trajectoire.
Pour la trajectoire 1, par exemple, même si on demeure en poste, ce sont des personnes
infirmières qui ont quand même vécu beaucoup d'instabilité au niveau de la charge de
travail, au niveau de
la façon dont ils devaient donner les soins, des collègues qui sont venus travailler avec
eux aussi.
Ils ont eu beaucoup d'adaptation à faire.
Mais pour eux, de demeurer sur leur poste, c'était quelque chose qui était plus sécurisant
versus de changer de poste, ce que d'autres personnes ont décidé de faire, ou de quitter.
Donc, de rester dans leur équipe de travail, ils connaissaient leurs collègues, leurs
gestionnaires.
C'était une bonne façon pour eux de s'adapter à la pandémie et au contexte de la crise
sanitaire.
Versus, par exemple, les autres trajectoires où on a plutôt vu un changement.
Donc, la façon de s'adapter, c'était plutôt d'aller vers un changement de carrière ou un
retour pour les personnes retraitées.
Eux, c'était d'être actif dans le combat contre la pandémie qui, pour eux, c'était de se
sentir utile.
C'est sûr que pour les infirmières qui ont été, par exemple,
réaffectées contre leurs grés à plusieurs reprises ou qui ont subi beaucoup de temps
supplémentaire obligatoire, c'était plus difficile pour elles de s'adapter comme elles le
feraient normalement.
C'est sûr que quand tu dois travailler plusieurs 12 heures ou des 16 heures en ligne, ça
devient compliqué de peut-être aller au gym.
C'est sûr, les gyms étaient fermés, il y avait le contexte pandémique qui mettait un frein
aux moyens d'adaptation que les gens prennent habituellement.
Il n'y avait peut-être pas le moyen le vendredi soir
d'aller prendre une petite coupe de vin avec des amis ou d'aller manger au restaurant.
Puis il n'y avait pas de possibilité non plus d'aller peut-être au gym habituel trois ou
quatre fois par semaine.
Puis en plus avec l'horaire, les TSO, ça ne laissait pas non plus la place à la maison
pour utiliser les stratégies qu'elles utilisent habituellement.
En plus, d'être dans des milieux inconnus où elles ne sont pas habituées d'être, avec des
gens qu'elles ne connaissent pas,
souvent pas vraiment de gestionnaires accessibles, d'après ce que j'ai vu dans les
entrevues que j'ai analysées.
Pour la trajectoire, par exemple, 3, il y avait peu de stratégies d'adaptation qui étaient
mises en place parce qu'il n'y avait pas de possibilités d'en mettre.
Ce sont des gens qui ont comme un peu subi la pandémie, subi les réaffectations.
Ils avaient peut-être trop d'ancienneté pour quitter leur poste,
ou des engagements familiaux qui ne leur permettaient pas de retourner aux études, ou tout
ça avec des engagements financiers aussi.
C'étaient aussi beaucoup des infirmières et infirmiers qui provenaient de milieux, par
exemple, de santé publique, de santé scolaire, donc des milieux où ils n'étaient
pas nécessairement sur les étages d'un hôpital à donner quotidiennement des soins aux
patients.
Moi je ne suis pas infirmière, je n'emploie peut-être pas toujours la bonne terminologie
par rapport aux soins aux patients parce que je ne connais pas du tout ça.
Bref, je pense que les soins qui sont donnés sont quand même différents dans un hôpital,
versus un GMF, versus en santé publique ou en santé scolaire, ce n'est pas la même chose.
En plus de devoir s'adapter à un nouveau milieu, une nouvelle équipe, ils avaient souvent
des soins à donner que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire.
Toute cette situation-là nuisait beaucoup aux capacités d'adaptation pour nos infirmières
et infirmières de cette trajectoire-là, versus peut-être la trajectoire 4, eux, leur façon
de s'adapter, ça a été de démissionner, de retourner aux études, de compléter une maîtrise
ou un autre programme, de devenir
IPSPL, par exemple, pour pouvoir aller en groupe de médecine familiale ou d'autres
éléments comme ça.
Notre trajectoire 4, c'est majoritairement utiliser une stratégie d'adaptation active de
changer de milieu versus d'autres trajectoires, par exemple.
C'est sûr qu'on voit vraiment des différences à ce niveau-là entre nos soignants et entre
les milieux, ce qu'on peut être aussi.
C'est clair, je me replonge un peu dans mes souvenirs de la pandémie pour avoir contribué
en travaillant entre autres aux soins intensifs, puis dans les unités COVID.
Non seulement c'était de l'inconnu à cause de la maladie elle-même, on ne connaissait pas
cette maladie-là au début, puis on se préparait, on avait vu les scénarios catastrophes en
Italie, puis
le manque de respirateurs, puis ils ont préparé des protocoles, ils ont essayé de
s'adapter en disant, bien, on va se préparer activement à la crise qu'on voyait venir.
Mais moi, je suis déjà en milieu hospitalier, donc je n'étais pas...
Oui, il y avait de l'inconnu, mais j'étais quand même majoritairement encore dans ma zone
de confort.
Alors que là,
je regarde un peu les trajectoires que tu décris.
Il y a clairement des personnes qui ont été catapultées en dehors de leur zone de confort,
puis qui se sont peut-être même senties prisonnières des choix qu'elles avaient fait
avant, ou du non-choix auquel elles étaient confrontées, puis là d'être mises dans des
situations comme ça.
J'imagine qu'il devait y avoir beaucoup un sentiment d'impuissance qui ressortait.
Oui, puis le mot que tu as dit, de se sentir "prisonnière", c'est un peu ça aussi que j'ai
vu qui ressortait de l'expérience des gens qui m'ont raconté ça, c'est qu'ils n'avaient
plus de contrôle sur grand chose dans leur vie.
Les mesures sanitaires étaient appliquées dans leur vie personnelle, mais aussi au niveau
du travail.
Quand sont arrivées les réaffectations involontaires, souvent il y en avait une qui
suivait l'autre, puis qui suivait l'autre...
Les personnes n'avaient pas nécessairement le choix de dire ce milieu-là ou tel milieu.
Probablement parce qu'il n'y avait pas de possibilité dans le système pour laisser le
choix toujours.
Les milieux avaient besoin d'aide, il y avait des milieux en crise, ça prenait des gens
qualifiés pour aller le faire.
Puis ça reste que ce sont des infirmières et des infirmiers avec des formations, des
infirmières et d'infirmiers qui
mmh
ont à quelque part en dedans d'eux les qualifications nécessaires pour aller le faire,
mais des fois ça faisait longtemps.
C'est sûr qu'il y avait beaucoup de craintes de faire des erreurs dans les soins.
J'ai rencontré plusieurs infirmières aussi qui arrivaient des fois dans des milieux où
toute l'équipe régulière était absente parce qu'il y avait eu éclosion.
Tout le monde était isolé et là, elles arrivaient toutes seules des fois ou avec d'autres
personnes qui étaient nouvelles aussi dans le milieu
pour intervenir.
C'étaient des situations qui étaient très insécurisantes et qui demandaient beaucoup
d'adaptation pour les infirmières.
Puis, elles n'étaient pas toujours en mesure de s'adapter, tout dépendant du contexte.
Ce qui a amené, entre autres, des fois à des congés de maladie, des épuisements
professionnels parce que les conditions actuelles ne leur permettaient pas de s'adapter,
ce n'était
pas possible.
Même si elles essayaient de sortir prendre une petite marche sur l'heure du dîner ou dans
un petit trou dans la journée ou le soir, ce n'était pas suffisant à ce moment-là pour
leur permettre.
Ça prenait du soutien supplémentaire ou une latitude supplémentaire pour pouvoir
s'adapter.
Un peu comme tu disais, on était privé de certains mécanismes d'adaptation qu'en temps
normal on aurait été en mesure d'utiliser.
L'exemple que tu nommes, une infirmière qui est nouvelle sur une unité, puis là tout le
monde est parti...
En temps normal, cette infirmière-là, elle aurait pu demander du renfort ou du soutien
émotionnel de la part des collègues, puis là, t'es pas capable.
Non, c'est ça.
Ce que les infirmières mentionnent aussi, c'est qu'elles ce sont senties comme en temps de
guerre où tout le monde est en mode survie, puis chacun fait un peu pour soi.
Ça, c'est pas partout pareil, là.
Tu sais, mais il y a des milieux où il y avait beaucoup de soutien et tout ça...
Mais il y a quand même des milieux où tout le monde était tellement en mode survie que
c'était un peu : "Moi, toute l'énergie que j'ai, je vais la garder pour moi parce que j'en
ai pas pour d'autres choses.
Je viens travailler, puis je me couche, je reviens travailler, puis c'est tout."
C'était comme une espèce d'alerte, de mode survie pour les infirmières, versus d'autres
qui sont peut-être restées dans leur milieu.
Elles vivaient aussi la crise, comme les infirmières qui ont été délestées, mais elles
restaient dans un milieu connu avec des collègues qu'elles connaissaient, et qui pouvaient
se supporter.
C'était plus facile peut-être pour ces personnes-là
de ventiler, de s'acheter une boîte de muffins avec les collègues le matin.
Des fois, ce sont des petites choses banales comme ça qui font qu'on va passer au travers
de la journée et qu'on va être capable de revenir le lendemain, puis le jour suivant, puis
tout ça.
C'est tout le contexte autour aussi de la personne qui va lui permettre de s'adapter à la
situation de crise qu'elle va vivre, donc là, la COVID.
S'il y avait du soutien
du partenaire à la maison, est-ce qu'il y avait des jeunes enfants qui ont été sortis de
la garderie ou de l'école?
Tout ce contexte-là peut agir comme une ressource ou une contrainte à l'adaptation des
gens.
La personnalité aussi, il y a des gens qui ont une personnalité qui leur permet ou des
expériences de vie qui font en sorte qu'ils ont déjà un bon bagage de stratégies
d'adaptation versus d'autres personnes qui vont peut-être avoir moins développé ces
réflexes-là,
que ça va être une épreuve, un défi plus grand que d'autres.
Je trouve ça intéressant parce que moi je suis spécialiste en médecine interne, donc tout
l'aspect de la réponse du corps humain, du point de vue médical, physiologique, je trouve
ça intéressant.
La réponse de stress, quand on est en mode survie, c'est de se battre ou de fuir.
C'est un peu dans ces deux catégories-là que les gens allaient se ranger, soit qu'ils
avaient les mécanismes assez suffisants ou la résistance au stress assez suffisante pour
se battre, puis le mot que tu utilises, la réaction "d'être en guerre", finalement.
De l'autre côté, les personnes qui, pour un paquet de raisons, avaient moins de résistance
au stress ou qui étaient mises dans des conditions de stress qui étaient beaucoup trop
élevées pour qu'une personne même normale puisse s'adapter, c'est sûr que quand ces
mécanismes s'épuisent, ça peut entraîner de l'épuisement, des complications
psychologiques, même physiques.
Oui, puis tu sais, on le voit dans la trajectoire 3 et même la trajectoire 2, même la 1
aussi, que les gens qui sont restés en poste, les gens qui ont changé de poste, mais qui
sont restés pour l'organisation, puis les infirmières qui ont été réaffectées contre leur
gré, qu'il y a des impacts encore aujourd'hui.
Bien là, je dis encore aujourd'hui, mais j'ai terminé les entrevues l'année passée, mais
bref, encore l'année passée, deux, trois ans après la pandémie, bien, ils ressentent la
fatigue.
Leurs habitudes ont changé, ils sont peut-être moins actifs, mangent un peu moins bien,
puis ils ne sont plus autant dévoués au travail qu'avant.
Il y a un lien qui parfois s'est brisé avec l'employeur.
La confiance a été perdue du fait de ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie.
Des fois, il y avait des choses qui se sont passées avant la pandémie avec des
insatisfactions au travail, mais qui sont venues s'accentuer pendant cette période-là,
pour certaines personnes que j'ai rencontrées.
Tu me fais penser à la recherche de sens aussi.
Quand on choisit des professions dans le domaine des soins, souvent on le fait, on a des
raisons personnelles, mais on le fait pour donner.
La relation de soin, je trouve que c'est un privilège de pouvoir soigner.
Mais quand on est mis dans des situations exceptionnelles comme ça, en tout cas moi je
vais parler pour moi...
Mais il y a eu des moments où j'ai perdu le sens de pourquoi je fais ce métier-là, puis à
quoi ça sert.
On avait des moments où est-ce que je me sentais tellement impuissant de voir des patients
décéder,
des expériences traumatisantes comme soignant, des blessures morales, aussi, parce qu'on a
été forcé de développer des protocoles en cas où on aurait manqué par exemple de
respirateurs.
Il fallait développer des protocoles pour dire qui va pouvoir bénéficier d'avoir le
respirateur et qui va peut-être ne pas avoir l'occasion d'être sauvé.
Je me rappelle, moi, j'avais même refusé.
J'ai un peu honte de le dire maintenant, mais c'est vrai, j'ai refusé d'apprendre, de lire
ces protocoles-là parce que c'était tellement contre mes valeurs de soignant, de me dire,
bien là, je vais devoir choisir qui va vivre, qui va mourir.
Puis ça avait été très difficile ce genre de blessure morale-là.
Et effectivement, quand on perd le sens de ce qu'on fait, souvent la motivation vient ou
il y a des mécanismes d'adaptation, mettons, plus mésadaptés qui vont sortir.
Oui, en effet.
Ce que tu dis, je l'ai beaucoup observé aussi pendant mes entrevues.
C'est quelque chose que les infirmières et les infirmiers que j'ai rencontrés
rapportaient.
Que pour eux, ça ne faisait pas de sens, les conditions dans lesquelles ils devaient
travailler.
Comme tu dis, des fois, les soins étaient ramenés à la base.
La base de ce qu'il faut pour maintenir les gens en vie.
Ce n'était pas beaucoup de temps passé avec chaque patient parce
qu'ils étaient en manque de personnel.
Tout ça, ça venait vraiment porter atteinte au sens qu'ils donnaient à leur profession.
Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient avoir comme pratique.
Aussi, ne pas sentir d'avoir la confiance ou la compétence de donner les soins qu'ils
devaient donner parce qu'ils n'avaient pas l'occasion d'être formés comme ils l'auraient
voulu.
Il n'y avait pas d'aide pour le faire.
Tout ça, c'est venu vraiment contribuer aussi à la perte de sens, à la perte de confiance
envers l'employeur et aussi à des gens qui ont décidé de changer de métier.
Carrément, que ces conditions-là, ça ne leur correspondait pas et que ça avait blessé leur
amour de la profession.
Ça, c'est sûr que ça a été observé.
C'est quelque chose que j'ai vécu aussi en tant que travailleuse sociale parce qu'on a
qu'on a vu une augmentation des gens sur les listes d'attente, puis là on devait prioriser
qui on va rencontrer versus qui on ne va pas rencontrer et qui va être en attente pendant
plusieurs mois, semaines.
Moi aussi, ça venait heurter mes valeurs dans ma profession.
C'est la même chose pour le personnel en centre hospitalier, c'est sûr, de devoir diminuer
la qualité perçue des soins qu'ils
voudraient ou qu'ils devraient donner pendant des périodes de crise comme ça.
C'est sûr que ça a un impact à long terme sur la santé mentale, la santé physique, tout ça
laisse des traces, ça transpose.
C'était ça ma prochaine question, en fait, que les impacts à moyen-long terme, on commence
à peine, je pense, à les mesurer.
C'est probablement...
On parlait des vagues dans la pandémie d'infection, on va dire plus de problèmes de santé
physique, mais je pense qu'on est encore dans une vague de la pandémie, mais qui est plus
insidieuse ou sur des impacts psychosociaux dont on commence à peine à se rendre compte à
quel point ça a laissé des traces, exactement comme tu dis.
Oui, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens ou les ressources
pour aller guérir ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie ou que c'est encore une situation
de crise au travail parce que les gens qui sont partis n'ont pas nécessairement toujours
été remplacés.
Ça fait que dans beaucoup de milieux, je pense, je parle peut-être à travers mon chapeau,
mais il y a encore une charge de travail qui est augmentée, il y a encore du mouvement de
personnel qui fait que les équipes sont instables,
des nouveaux gestionnaires, que pour plusieurs personnes, on était encore en train de
reprendre notre souffle, puis il ne finit plus.
L'air vient pas.
c'est un peu ça.
Je dis que la médecine, c'est un trouble d'adaptation chronique.
Ça s'applique à toutes les catégories de soignants.
On est tellement souvent mis en dehors de notre zone de confort.
Des petits répits entre les crises, c'est difficile de prendre le temps
de reprendre nos forces puis de reconnecter avec des choses qui nous font du bien.
Je vais parler pour moi, durant mes études ou début de pratique, durant la pandémie, il y
a plein de choses pour lesquelles j'avais des passions avant, qui me faisaient du bien.
Par exemple, le piano ou l'art en général.
On dirait que ça devient tellement partie de notre identité d'être soignant, de donner et
de rendre service qu'à un moment donné, on s'oublie un peu comme personne.
Ce sont ces choses-là que je savais qui me faisaient du bien.
Je n'étais plus capable d'y accéder.
Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté toutes sortes d'activités, toutes
sortes de stratégies qu'ils utilisaient avant ou pendant la pandémie parce qu'ils
n'avaient plus d'énergie pour le faire aussi, puis ce n'était plus une priorité.
Tu sais, quand on choisit une profession qui est orientée vers la santé, vers l'aide
portée aux gens, puis tout ça, on a de l'intérêt, on a une personnalité qui est portée
vers ça pour plusieurs personnes.
En tout cas, quand les gens ont besoin de nous, on y va, on se propose.
Puis ça peut prendre du temps avant qu'on se rende compte que là finalement c'était trop,
puis après ça ce n'est pas toujours possible de se retirer de ces situations-là.
Par exemple pour des infirmières qui ont peut-être accepté d'être réaffectées
volontairement au début, puis qu'après ça elles ne pouvaient plus revenir sur leur poste
parce qu'on avait besoin d'elles encore dans les milieux critiques.
Ça fait que tout ça s'accumule, puis à un moment donné on le ressent mais des fois
plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, plusieurs années, même, encore.
Puis c'est pour ça aussi que dans notre projet, dans ma maîtrise, on considère qu'il y a
des contraintes à l'adaptation qui peuvent être liées à la santé et l'énergie, que des
infirmières, des infirmiers ou d'autres professionnels de la santé qui ont déjà eu des
congés maladies, des épuisements professionnels, des troubles d'adaptation, mais à chaque
fois ça peut laisser une petite trace.
Peut-être une trace qui va faire en sorte que la prochaine fois tu aies plus de ressources
parce que tu as consulté, parce que tu as développé des mécanismes, mais aussi
une trace peut-être qui va agir comme une contrainte parce qu'entre ton congé, maladie ou
ce dont tu t'es remis, mais peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps et que tout de
suite on a vécu une crise et que là tu vas traîner un petit manque d'énergie, ou qu'on n'a
pas récupéré suffisamment, ou on n'a pas eu le temps de remettre en place, nos stratégies,
ou que peut-être on a abandonné et qu'on n'a pas repris pour toutes sortes de raisons.
Mmh-hmm.
Tu sais, toute cette fatigue-là aussi qui était présente dans le réseau de la santé, même
avant la pandémie, bien, s'est accentuée, puis a pu nuire un peu à l'adaptation du
personnel soignant parce qu'il y avait déjà des antécédents qui n'étaient pas rattrapés au
complet pour toutes sortes de raisons, puis tandis que pour d'autres personnes, peut-être
qu'on avait développé des ressources pendant ces types d'épreuves-là.
Les programmes d'aide aux employés, consulter un psychologue, des travailleurs sociaux,
aller se faire masser une fois par semaine, c'est non négociable.
Bref, ces affaires-là, qui pendant la pandémie, par exemple, ont été arrêtées, mais toutes
ces petites stratégies-là qu'on met en place pour nous aider à être en forme
quotidiennement, puis à être disponible au travail, puis à être disponible pour notre
famille, nos amis, automatiquement, quand il y a des rushs de stress, des rushs au
travail,
des services qui sont peu accessibles, c'est sûr que ça va avoir un impact chez les gens
qui le vivent.
Et puis, dans les stratégies d'adaptation, j'imagine qu'il y en avait des plus toxiques ou
mésadaptées.
Je pense entre autres à la consommation de substances.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé?
Oui, c'est quelque chose que j'ai observé.
L'augmentation de la consommation d'alcool pendant la pandémie, consommation de drogues,
médicaments, aussi consommation excessive de réseaux sociaux ou de jeux vidéo.
Ça, ce sont des choses aussi que j'ai vues, que moi, j'appelle dans mon projet de maîtrise
des stratégies d'évitement mental ou de désengagement, des gens qui avaient besoin de se
couper de ce qu'ils vivaient,
en fait, pendant la pandémie.
Fait que oui, c'est quelque chose que j'ai observé majoritairement dans la trajectoire 3
ou 4, donc les gens qui ont été réaffectés, les gens qui ont été réaffectés pour
démissionner, mais il y a eu une augmentation peut-être des stratégies qu'on pourrait
considérer comme étant mésadaptées.
Peut-être que pour certaines personnes, de prendre une petite coupe de vin de plus, alors
que c'était juste une par jour, c'était correct.
On ne peut pas considérer une stratégie comme en tout temps
Mmh.
mésadaptée pour une personne, ça reste que la consommation, ça peut mener souvent à
d'autres problématiques quand il y a une augmentation qui devient problématique, par
exemple.
Ça, c'est ressorti.
Je ne pourrais pas te dire les proportions dans mes stratégies, mais c'est sûr que c'est
venu sur le sujet.
Mais ça, ça a été observé aussi dans la population en général qu'il y a eu une petite
augmentation de la consommation pendant la pandémie.
Pour plusieurs personnes, c'est revenu à la normale.
Peut-être que pour d'autres, ça s'est maintenu à travers le temps ou même augmenté.
C'est ça que je me demandais, si c'est quelque chose qui était temporaire, relié à la
situation, au contexte ou la quantité de stress, ou si c'est quelque chose finalement qui
va se maintenir dans le temps.
Puis je pense que tu as nommé un peu ma perception par rapport à cet enjeu-là, qui est la
déconnexion de soi, le besoin de se dissocier par rapport au trauma,
auxquels on est exposé de par la crise elle-même, versus les traumas non réglés, notre
bagage d'avant, comme soignant...
Oui, on exerce un métier, une profession, nous sommes des humains aussi, puis on a tous eu
nos expériences de vie, puis c'est rarement à propos des substances, c'est plus par
rapport
à la souffrance, puis qu'est-ce qu'on essaie d'auto-gérer finalement avec ce moyen-là.
Oui, c'est sûr que ça reste un moyen qui est considéré comme étant peu proactif dans la
résolution du problème.
C'est temporaire, ça permet aux gens de se déconnecter un peu de ce qu'ils ont vécu, mais
ce n'est pas une stratégie qui est considérée comme de résolution de problèmes, d'aller
consommer.
Sur le long terme, ça peut être problématique justement, plus qu'être aidant, versus
d'autres stratégies qui vont être
plus orientées vers la résolution de problèmes, puis le contrôle des symptômes, comme par
exemple d'avoir des passions, de pratiquer des activités physiques, l'art, la musique,
d'avoir des réunions entre amis, de ventiler...
Toutes ces stratégies-là qui vont être plus au niveau de la gestion des émotions, puis des
stratégies plus de résolution de problèmes.
D'y aller vers un changement dans le milieu de travail, un changement de poste, de
s'impliquer activement peut-être dans la résolution de la crise, dans la recherche de
solutions, de faire des modifications sur l'organisation à la maison pour s'aider à passer
à travers.
Toutes ces stratégies-là sont peut-être plus actives pour s'aider à passer à travers.
Mais les gens ont toutes sortes de contraintes aussi dans leur vie ou de ressources.
Des fois, ce n'est pas possible
d'aller consulter...
le programme d'aide aux employés a de l'attente, les assurances remboursent trop peu, il y
a toutes sortes de choses.
Il y a des parents qui ont plusieurs enfants, qui sont peut-être des familles
monoparentales, mais quand ils arrivent à la maison, ce n'est pas toujours possible
d'aller une heure dans le bain.
Les enfants demandent, il faut préparer les lunchs du lendemain...
Des fois, il y a tout un contexte autour de la personne qui fait qu'elle va avoir la
possibilité de s'adapter ou non
et qu'il va y avoir des stratégies qui vont être plus accessibles pour elle versus pour
quelqu'un d'autre.
Une des choses qui ressort de plusieurs invités du balado, c'est que c'est rarement, en
tout cas pour nous, un problème d'accessibilité aux ressources parce qu'étant donné qu'on
est dans le réseau, on a quand même le privilège d'avoir accès à beaucoup de ressources.
Je me remets dans la situation quand j'allais moins bien, je veux dire, j'étais
tellement...
Tu nommais la fatigue, mais c'était très vrai.
La fatigue physique, la fatigue cognitive, la fatigue de compassion aussi.
Tout ça faisait en sorte que je savais qu'il y avait des ressources disponibles.
Pour nous, les médecins, on a le Programme d'aide aux médecins du Québec,
qui est un organisme qui vient soutenir les médecins, faire de l'accompagnement anonyme
avec des médecins-conseils.
Il y a plein d'autres initiatives pour les autres professionnels de la santé.
Mais même si je savais que ça existait, je n'avais plus le jus, l'énergie pour aller
mobiliser ces ressources-là.
Oui, c'est ça que j'ai observé aussi et qu'on observe, c'est que même des fois, même si
les ressources sont disponibles et accessibles, c'est peu utilisé.
Dans le fond, l'aide formelle va être peu utilisée.
C'est encore peut-être sous-évalué, méconnu aussi.
Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, de rencontrer un travailleur social, une éducatrice
spécialisée, un psychologue...
Ce que j'ai observé dans ma pratique professionnelle, mais aussi dans mes entrevues, c'est
que si l'aide n'est pas disponible au moment où on la demande, ça se peut que trois
semaines, trois mois, six mois plus tard on soit appelé, mais on a perdu le momentum.
Les gens, ça ne leur tente plus à ce moment-là, ils sont ailleurs.
La situation s'est peut-être dégradée ou améliorée.
On perd des fois des gens en n'ayant pas la possibilité de leur offrir de l'aide au moment
où elle est demandée.
C'est un problème plus grand que juste un service ou une personne.
C'est une réalité qu'il y a de l'attente en ce moment pour avoir des services, que ce soit
au privé ou au public.
Des fois, c'est plusieurs semaines, même plusieurs mois.
Il y a malheureusement des dégradations qui sont attribuées aux demandes d'aide quand il y
a beaucoup d'attente.
Tout ça s'accumule et ça va faire en sorte qu'une personne va être prise en charge
peut-être trop tard pour avoir l'aide qui lui permettrait de s'adapter au bon moment.
Je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire parce que je rajouterais à ce
délai-là tout le délai avant la demande d'aide.
Du moment où est-ce que j'ai réalisé que j'allais moins bien, que j'avais besoin d'aide,
que j'ai formulé la demande d'aide, ça a pris des mois.
Puis après ça, effectivement, du moment où est-ce que je demande de l'aide, l'aide dans un
monde idéal, j'aurais voulu l'avoir tout de suite, le monde étant ce qu'il est, avec les
ressources qu'on a, c'est clair qu'on est obligé de faire des choix qui sont parfois
déchirants.
Puis oui, il faut prioriser.
On est donc en mode de gestion de crise souvent, alors que
tout le monde aimerait tellement ça, être en mesure de faire plus de prévention
finalement, puis de faire en sorte que les gens ne se rendent pas à ce point-là.
C'est bon ce que t'amènes de dire aussi que souvent on attend trop parce que c'est le
temps qu'on se rende compte.
Parce que moi j'ai déjà eu aussi une période où j'allais moins bien.
Quand je travaillais comme travailleuse sociale et où j'ai dû prendre un congé puis
consulter.
Mais le temps que je me rende à ce constat-là, souvent on est rendu avancé quand même dans
l'état de fatigue.
Puis ça devient difficile de fonctionner normalement.
Puis ça prend plus de temps à rattraper aussi.
J'ai été chanceuse au moment où j'ai eu besoin.
L'aide était disponible, elle est arrivée quand même assez rapidement.
Ça m'a permis de me remettre.
Mais effectivement, si on m'avait dit qu'on ne me rencontrerait pas avant trois ou quatre
mois, peut-être que ça aurait été plus difficile et plus long pour moi de m'en remettre.
C'est la même chose en ce moment dans toute sorte de services.
Si j'appelle pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, des fois j'en ai pour trois ou
quatre mois avant d'avoir un rendez-vous.
Je pense que c'est assez généralisé et on est chanceux qu'on soit capable d'accéder à des
services plus rapidement.
Ça dépend des périodes et des moments.
Il y a des périodes qui sont plus critiques dans l'année, où il y a plus d'achalandage
vers les services aussi.
Ce qui m'amène à toucher au sujet des solutions.
Dans ton projet, est-ce que tu as vu émerger des tendances par rapport aux solutions qui
étaient proposées par les gens que tu as questionnés?
Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs solutions qui ressortent.
C'est sûr que quand on se ramène en temps de crise, des fois ces belles solutions-là, on
n'est pas en mesure de les appliquer, mais il y a quand même des choses que je trouve
qu'il faudrait réfléchir à mettre en place.
Puis ça va être ça aussi, l'article que je vais sortir, qu'on va sortir aussi en tant
qu'équipe pour le gros projet, qu'on va venir mettre en évidence.
C'est qu'en fait, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour soutenir nos
soignants dans un contexte où on doit les obliger d'une certaine façon
à travailler dans des conditions qui ne sont pas idéales.
Mais c'est qu'entre autres, quelque chose qui revenait beaucoup, c'est lors des
réaffectations, peut-être de réaffecter en équipe de deux personnes dans un même milieu.
Donc, deux collègues qui vont aller travailler ensemble dans un milieu de crise.
Au moins, il y a une personne que tu connais qui va t'aider, tu vas avoir une ressource,
une personne qui va pouvoir ventiler avec toi, faire les soins avec toi, s'entraider.
Donc ça, c'est des choses quand même qui sont revenues.
C'est sûr que l'auto-gestion des horaires, la diminution des temps supplémentaires
obligatoires, ça revient tout le temps, ce n'est pas nouveau.
C'est un gros problème qui nécessite beaucoup de travail, mais plus les gens sont imposés,
plus il y a de l'insatisfaction, plus après ça on va perdre d'autres ressources, remettre
de la pression sur le système.
Puis il y a des études aussi qui démontrent que trop de réaffectations, ça nuie à la
satisfaction au travail et ça peut nuire ultimement à la qualité des soins qui sont donnés
aux patients et à la sécurité aussi.
De rester en 16 heures, je me rappelle, j'ai une infirmière qui m'a dit que je devais
rester en 16 heures, mais je n'étais même pas capable de conduire mon auto pour aller chez
moi après mon shift et le lendemain pour revenir.
Je dois donc donner des soins à des patients alors que je suis dans un état où je me sens
pas apte à conduire ma voiture.
Je pense qu'il faut repenser et essayer d'aller avec le volontariat.
Je sais que dans certains hôpitaux anglophones, j'ai eu la chance d'avoir des gens en
entrevue dans ces milieux-là, ce sont des quarts de 12 heures, les temps supplémentaires
obligatoires, au moment où j'ai passé l'entrevue, ce n'était pas quelque chose qui était
appliqué généralement.
C'était plus le volontariat qui était utilisé, puis ça permettait aussi de couvrir les
quarts de travail seulement avec le volontariat.
Je pense qu'il y a peut-être du travail qui pourrait être fait pour augmenter le sentiment
d'implication, d'appartenance à l'organisation, mais ça passe par aussi améliorer les
conditions de travail, le fondement des conditions de travail.
C'est sûr que tout ce qui est de favoriser le bien-être au travail, ça devrait aussi être
une priorité, donner de l'accessibilité
à des douches sur un milieu de travail, à des installations peut-être, un gym, un cours de
yoga.
Ça se fait actuellement aussi dans les milieux de soins.
C'est de ça dont je parlais avec mon directeur Christian, justement, il y a quelques
jours.
C'est que des fois, il va y avoir des cours, par exemple, un yoga sur l'heure du dîner,
mais l'infirmière qui a 45 minutes d'heure du dîner, elle n'a pas le temps d'aller faire
son heure de yoga sur l'heure du dîner, de prendre sa douche puis de manger, versus
peut-être moi dans mon cas,
qui travaille en recherche, je peux prendre mon heure au complet et je peux même prendre
un dix minutes pour manger mon lunch à mon bureau.
Le personnel soignant sur le plancher, toi en tant que médecin, les infirmières, quand
votre temps de dîner est complet, il faut être disponible pour les soins.
On ne peut pas être en train de manger la sandwich en faisant le tour.
Des fois, les services qui sont offerts en milieu de travail pour favoriser le bien-être,
ce n'est
pas toujours possible pour les gens de les utiliser.
C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que les ressources sont là, mais qu'elles ne sont
pas utilisées.
Peut-être que pour l'infirmière, le PAE, le programme d'aide aux employés, le moment
qu'elle se fait offrir pour avoir une rencontre, ce n'est pas aussi possible pour elle.
Parce ce qu'elle est de nuit, elle fait des 12 heures, il y a toutes ces choses-là
auxquelles des fois on ne pense pas.
On dit, voyons, on met des choses à disposition, mais elles ne pas utilisées.
Mais c'est parce qu'en tant que gestionnaire ou personne en recherche ou autre,
pour nous, c'est accessible, mais pour les gens qui sont aux soins, ça ne l'est pas pour
toutes sortes de contraintes qu'on oublie.
Les garderies en milieu de travail aussi, s'assurer d'offrir les repas quand on reste en
temps supplémentaire obligatoire, puis pas juste la sandwich distributeur, toutes ces
choses-là, considérer la conciliation travail-famille quand on impose, tous ces éléments
organisationnels-là vont aider
nos soignants à s'adapter.
Donc c'est à toutes ces solutions-là qu'il faut penser.
L'accompagnement aussi des jeunes infirmières quand elles arrivent sur le plancher, c'est
quelque chose qui est ressorti, qu'elles ne se sentaient pas assez accompagées.
Des fois même dans les équipes, il n'y a pas de bonne relation, des bonnes relations de
travail qui peuvent nuire à la satisfaction et à l'adaptation quand elles n'ont pas de
lien avec des collègues.
L'accompagnement, lorsqu'elles sont réaffectées aussi contre leur gré, mais souvent
pendant la pandémie, les personnes étaient laissées un peu à elles-mêmes dans les milieux.
Il n'y avait pas de gestionnaire à qui se référer.
Il n'y avait pas de personnes sur place pour les aider.
C'est important quand on impose aux gens de les accompagner.
Je pense que dans le processus, s'assurer qu'elles vont bien.
Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient
qu'il n'y avait personne qui prenait des nouvelles d'eux, on faisait juste les appeler
puis leur dire, demain tu rentres à telle place.
Dans deux, trois jours, tu es à une nouvelle place.
Fait que, tu sais, tout ça, ça a quand même manqué pendant la pandémie pour toutes sortes
de raisons.
Tout le monde était débordé, tout le monde était en mode survie.
Il n'y a personne, je pense, qui était mal intentionné au fond de ça.
C'est tout le gros bateau qui s'est mis à fonctionner malgré nous comme ça.
Puis ce n'est pas nouveau comme solution.
Ce sont des solutions qu'on connaît, mais qu'il faut essayer de mettre en place.
Et ça, c'est tout un travail aussi.
Je résumerais en disant finalement, Il faut redonner le sentiment de contrôle, il faut
redonner de l'autonomie, de la flexibilité aussi dans notre approche.
L'exemple que tu as donné, moi aussi, je voulais prendre un rendez-vous pour de l'aide
psychologique.
Les rendez-vous qu'on m'offrait, c'était en plein milieu de la semaine.
J'étais souvent de garde, donc ce n'était pas adapté à ma réalité.
Les gens avec qui j'essayais de ventiler, qui ne sont pas dans le domaine des soins, me
disaient juste: "Prends une journée de congé pendant ta semaine de garde." Mais je ne peux
pas faire ça.
C'est tellement dichotomique, soit que je suis en forme, je suis là, je travaille, ou ça
ne va pas, donc je suis en arrêt travail, puis je ne suis pas là.
puis là, on réorganise les soins en fonction de mon absence.
Mais on dirait qu'il manque toute la progression, la capacité d'adaptation entre les deux.
C'est très vrai.
Je pense pas qu'il a personne qui soit mal intentionnée.
Je pense que la bienveillance était quand même très présente malgré la crise.
Mais comme tu dis, quand on est en mode "survie", à un moment donné, c'est sûr qu'on va
penser un peu plus à soi.
Je pense que c'est normal.
Puis je pense qu'à un moment donné, il n'y avait personne qui avait de solution.
Fait que même si les soignants appelaient pour dire, bien moi ça va pas, je ne peux pas
rester dans ce milieu-là, mais on n'avait pas d'options à ce moment.
Puis il en a qui ont tenté, j'ai besoin de...
Il y a eu pendant la pandémie des rehaussements obligatoires à temps complet, toutes ces
choses-là.
Mais quand la personne s'était organisée autour d'un temps partiel,
bien c'est sûr qu'à temps complet, ça demande un effort d'adaptation supplémentaire en
plus du contexte de travail actuel.
C'est de garder en tête tous ces éléments-là.
Notre personne infirmière qui est à temps partiel, peut-être que ce n'est pas possible
d'être à temps plein.
Puis celle qui refuse de rester en temps supplémentaire obligatoire, mais qu'elle a
peut-être des jeunes enfants à la maison, qu'elle n'a personne pour venir garder
ou qu'il va falloir qu'elle fasse des démarches, qu'elle fasse venir un grand-parent, un
ami, ou qu'elle va devoir payer pour faire garder, mais que ce n'est pas possible dans le
budget.
Il y a toutes sortes de choses aussi comme ça qu'il faut améliorer, que notre système soit
plus flexible, plus compréhensif à ces réalités-là, aussi.
Dans mes dernières questions, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de soignantes, de
soignants, des proches qui vont écouter le balado.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
En fait, j'aimerais leur dire que c'est important de se prioriser le plus possible, puis
d'être à l'écoute de notre corps, de nous-mêmes, puis que des fois, c'est important de
mettre la limite aussi.
Je sais qu'on veut aider, on veut se porter volontaire, on ne veut pas que nos collègues
soient imposés à notre place, mais c'est important de s'écouter, de prendre soin de soi.
Ce n'est pas ridicule de s'allumer une chandelle dans le bain, peu importe.
Toutes les petites stratégies d'adaptation qu'on peut mettre en place, il faut les
prendre.
D'aller consulter, aussi, ne pas attendre que ce soit trop tard.
Tu as fait plusieurs entretiens, tu commences à avoir une vision très élargie de la
problématique et du réseau.
Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour que tout monde aille
bien?
C'est une grosse question, mais je pense que le nerf de la guerre est vraiment dans les
conditions de travail, dans les horaires.
Je pense que c'est majoritairement là-dessus que les insatisfactions sont, puis que s'il y
a une plus grande flexibilité, une plus grande autogestion dans les horaires, je ne dis
pas qu'il n'y aura plus d'imposition, mais il faut redonner du pouvoir
à notre personnel soignant sur leur vie parce qu'ils en ont perdu beaucoup pendant la
pandémie.
Ma dernière question pour toi, si tu pouvais parler à Cloé, au début vingtaine, avant le
début de ton parcours, de tes expériences de vie, qu'est-ce que tu aimerais te dire ou
qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre avant?
J'aurais aimé comprendre que tout ne reposait pas sur moi.
Des fois, je me sentais comme si moi, si je ne le faisais pas, si moi je n'étais pas là,
que tout était de ma faute.
De ne pas prendre toute cette charge-là et d'en laisser aussi au système, aux gens, tout
ça.
ce qu'on peut contrôler, on se contrôle soi-même.
Merci beaucoup pour le partage et vraiment ton projet, félicitations parce que c'est un
travail colossal.
Je trouve que ça dresse un portrait qui m'apparaît très juste.
Je ne suis pas infirmière, mais j'ai côtoyé plusieurs infirmières et des infirmiers et je
trouve que tu décris bien
la réalité telle qu'on l'a vécue.
En même temps, ça donne un peu d'espoir, je trouve, sur le fait qu'on est capable de
s'organiser entre nous pour se redonner du pouvoir et reprendre du contrôle.
Oui, c'est surtout, tout n'est pas perdu.
Je pense qu'il y a moyen de s'inspirer peut-être ailleurs aussi ou dans d'autres hôpitaux
où on vit moins les problématiques de temps supplémentaire obligatoire ou de
réaffectation, qu'il faut aller prendre exemple ailleurs aussi.
Parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas bien, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de
choses qui ont sorti, des succès.
Il ne faut pas hésiter à s'en inspirer finalement.
Merci beaucoup pour l'heure passée ensemble.
J'espère que les gens vont être aussi inspirés par ton projet que je l'ai été.
En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Merci et à bientôt.
Bye bye.
Créateurs et invités